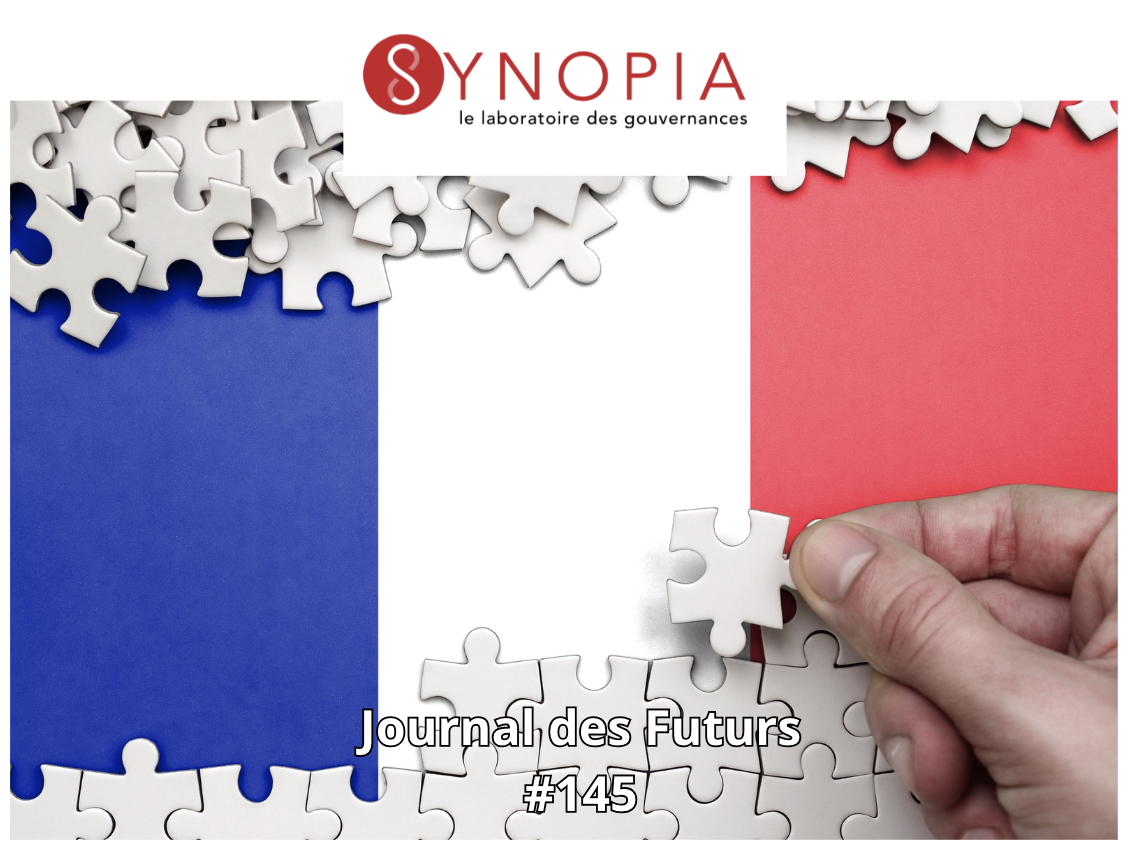Souveraineté industrielle française : entre ambition et contradictions !
Par Alexandre Malafaye, Président de Synopia
Le rejet, le 10 avril dernier, par l’Assemblée nationale du projet de loi visant à ratifier une modification du Protocole de Londres de 1996 — qui aurait permis le transfert transfrontalier de CO₂ en vue de son stockage géologique — illustre une nouvelle fois les contradictions et les incohérences françaises en matière de transition écologique et de réindustrialisation. Si le Sénat s’était montré favorable au texte, les députés, grâce à une mobilisation opportune et idéologique des écologistes et des insoumis, s’y sont opposés, mettant en péril plusieurs projets industriels majeurs. Une Commission mixte paritaire (CMP) tentera de trouver un compromis le 14 mai avant de faire à nouveau voter les deux chambres.
Une technologie non suffisante mais indispensable
Le captage et stockage du carbone (CCS) est pourtant reconnu par le GIEC comme une technologie indispensable, même si elle ne suffit à elle seule pour atteindre les objectifs climatiques. Il s’agit d’un outil complémentaire, nécessaire dans les secteurs où les émissions sont difficiles à éliminer, sans se substituer à une réduction structurelle des émissions. L’Agence internationale de l’énergie estime que cette technique devra représenter jusqu’à 15 % des efforts mondiaux de décarbonation d’ici 2050 — soit à terme, 7 milliards de tonnes de CO₂ à stocker chaque année. En France, la stratégie nationale prévoit de capter entre 4 et 8 millions de tonnes par an dès 2030, notamment dans la sidérurgie, la chimie, le ciment ou la métallurgie.
Ces filières, ancrées dans des bassins industriels structurants comme Le Havre, Dunkerque, Fos-sur-Mer ou Saint-Nazaire, ne pourront engager leur transition sans accès à des capacités de stockage. Certains critiquent le CCS comme une « béquille technologique », mais sans cette béquille, c’est l’ensemble du dispositif de décarbonation industrielle qui vacille.
Un verrou réglementaire aux conséquences stratégiques
La France ne dispose pas aujourd’hui de capacités de stockage suffisantes, ni sur terre — en raison d’une faible acceptabilité sociale — ni en mer, faute de cadre juridique. Par ailleurs, les projets de stockage géologique en France suscitent de fortes oppositions locales. Ainsi, le refus du maire de Pau (avant son arrivée à Matignon), François Bayrou, illustre cette tension autour de l’acceptabilité sociale du stockage « sous les pieds » des habitants.
D’autres pays européens ont déjà franchi ce cap, et pas des moins écologistes pour certains : Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Danemark… et exportent leur CO₂ vers des sites offshore comme Northern Lights en Norvège.
Le paradoxe est saisissant : ces infrastructures sont largement cofinancées par l’Union européenne — donc aussi par la France — mais nos industriels ne pourraient en bénéficier sans ratification du texte. Ce blocage créerait une distorsion de compétitivité majeure, compromettant la pérennité des projets engagés et affaiblissant notre capacité à revenir à un niveau de souveraineté industrielle sérieux.
Dans ce contexte d’instabilité politique permanente, il ne faut pas s’étonner que des grands opérateurs décident de réorienter leurs activités, avec toutes les conséquences massives que cela emportera sur l’emploi (destruction, abandon de projets…). Par exemple, l’annonce d’ArcelorMittal, le 24 avril, de supprimer 636 postes en France est sans doute à rapprocher du vote du 10 avril. Et il serait naïf de n’y voir qu’un simple prétexte destiné à justifier des restructurations : l’accès au stockage est devenu une condition d’existence pour les filières industrielles de demain.
Réconcilier écologie et industrie
La réindustrialisation peut et doit être écologique, à condition de repenser nos chaînes de valeur à l’aune des contraintes géopolitiques, de la raréfaction des ressources, et du coût de l’inaction climatique. À terme, les énergies renouvelables deviendront plus compétitives que les énergies fossiles, en raison de la hausse inévitable des coûts d’extraction et d’approvisionnement.
Dans cette perspective, le nucléaire sera amené à jouer un rôle central. Il fournit une électricité non-carbonée abondante, même si son avenir dépendra de notre capacité à sécuriser l’approvisionnement en matières premières, comme l’a montré la fin de l’exploitation d’Arlit au Niger.
Un rôle central, certes, mais pas suffisant, de même que les énergies renouvelables (ENR). Pour un certain encore, il sera impossible de se passer des énergies fossiles.
Un cap à redresser
La décision parlementaire autour de ce protocole engage bien plus qu’un article de loi : elle conditionne notre avenir énergétique, industriel et stratégique. Le CCS ne peut être le seul levier, mais il est incontournable. Il nécessite un encadrement strict, une gouvernance claire, et surtout une cohérence entre discours et action.
La transition énergétique ne se fera pas contre les entreprises, mais avec celles qui s’engagent et jouent le jeu. En retour, l’État doit reprendre son rôle de stratège, y compris en soutenant directement les secteurs critiques. Refuser cela, c’est installer notre pays dans l’impuissance volontaire, garantir son déclassement et signer la fin de nos ambitions de souveraineté.
A l’avenir, pour éviter de tels coups de barre politiques, il serait temps que le Parlement généralise les études d’impact et les évaluations préalablement à la fabrication de la loi. C’est une condition de sérieux démocratique, de pragmatisme et d’efficacité stratégique.
Alexandre Malafaye
Président de Synopia