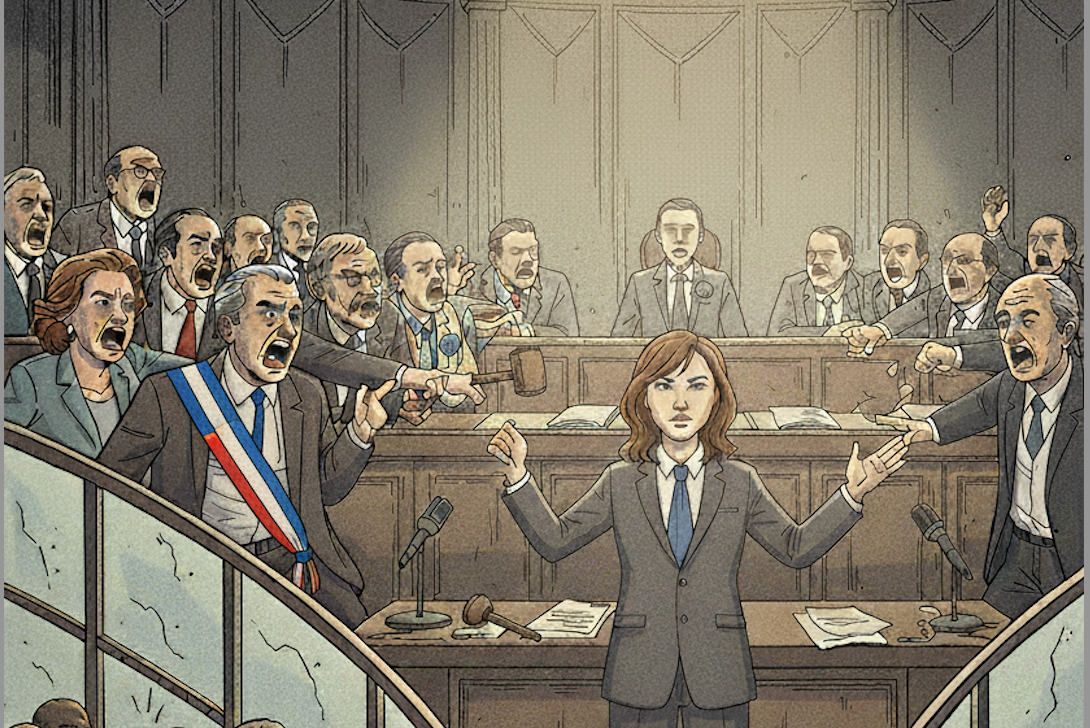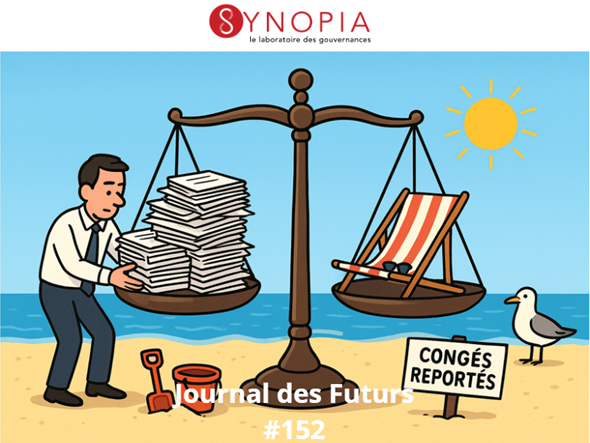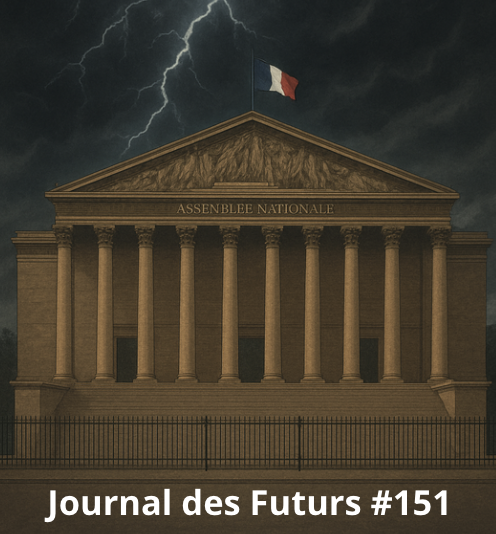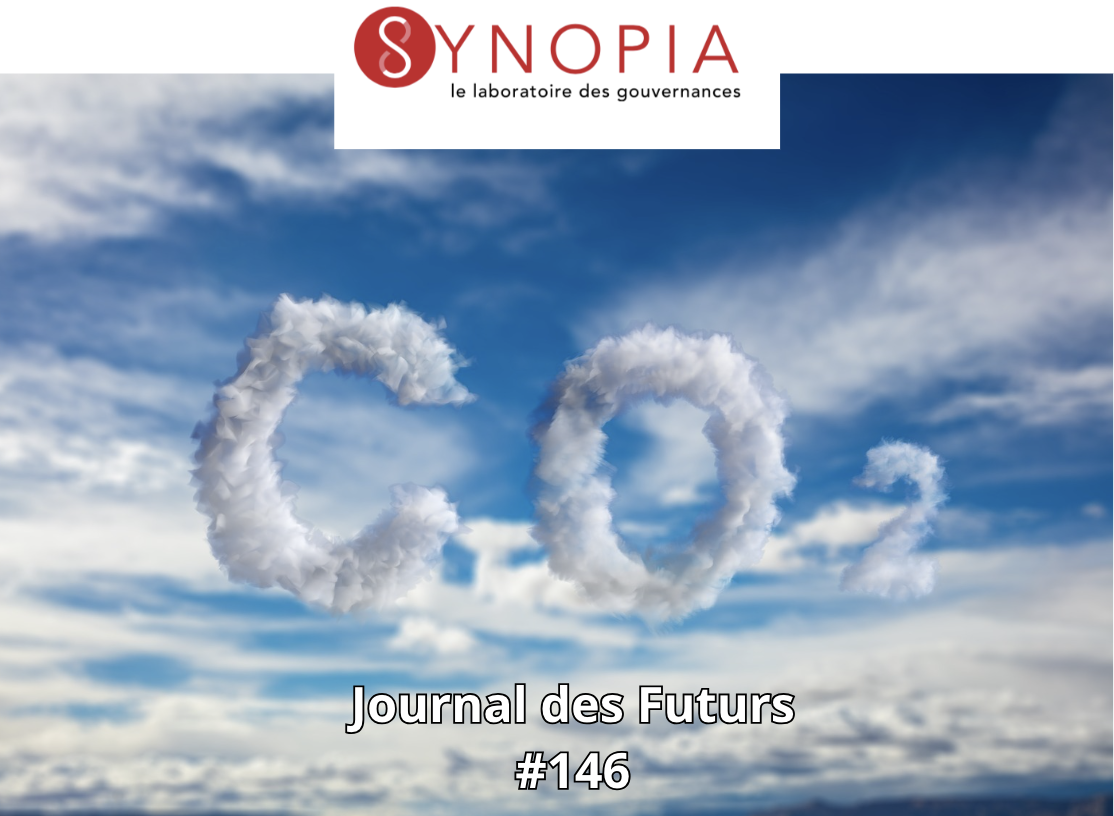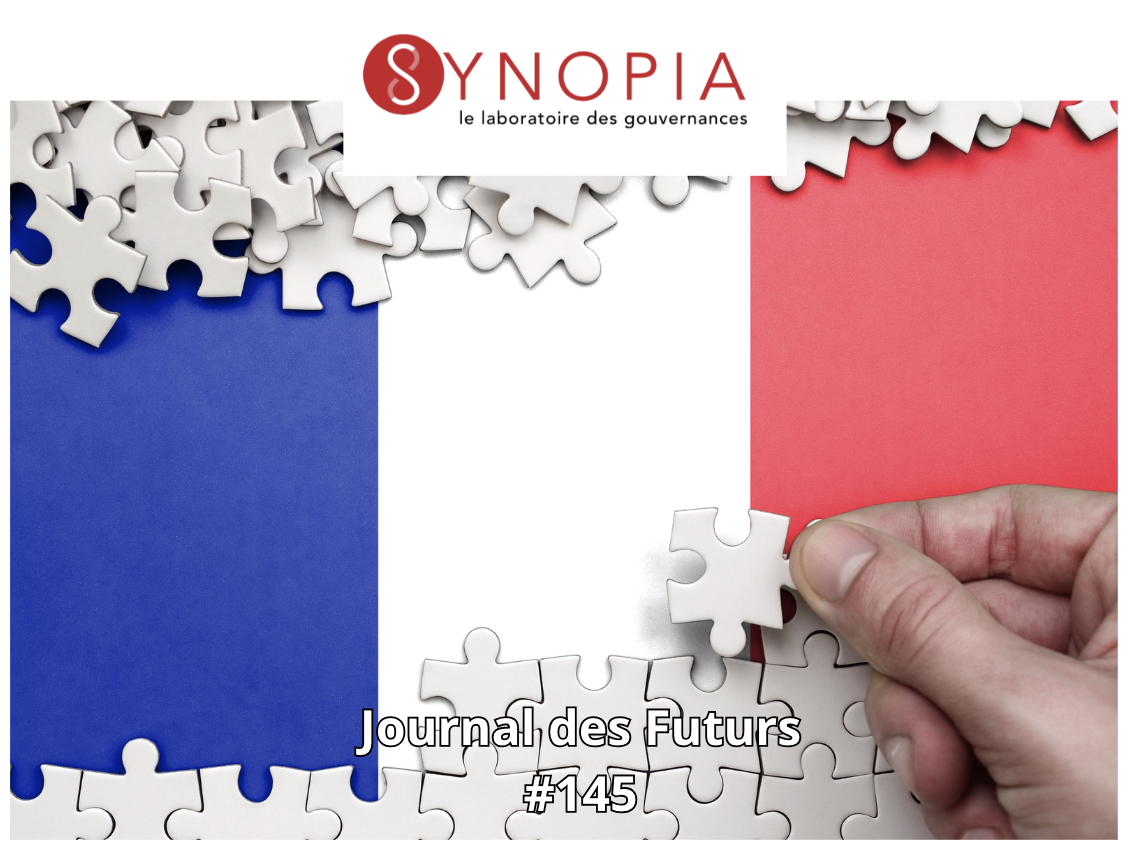Europe : l’été des l’humiliations
par Joséphine Staron, Directrice des études et des relations internationales de Synopia,
publié par le Journal du Dimanche, le 7 septembre 2025.
L’été 2025 restera comme une succession d’humiliations pour l’Union européenne. De sommet en sommet, de négociation en négociation, le Vieux Continent a accumulé les déconvenues et donné l’image d’un acteur secondaire sur la scène mondiale. Dans les grandes capitales, on a beau en minimiser la portée, la vérité est brutale : l’Europe a donné l’image d’un acteur impuissant, prisonnier de ses divisions et condamné à suivre les agendas des autres.
OTAN : la dépendance assumée
Au dernier sommet de l’OTAN, les Européens ont dû composer avec un Donald Trump plus arrogant que jamais, menaçant de réduire l’engagement américain et exigeant des Européens qu’ils portent leur effort de défense à… 5 % du PIB. Un chiffre irréaliste pour la majorité des États, et qui relève plus du coup de force rhétorique que de la planification stratégique. Pire : pour amadouer Washington, plusieurs pays européens se sont engagés à financer des achats d’armes américaines au profit de l’Ukraine. Autrement dit, une dépendance redoublée, financée par nos propres moyens.
Seule l’Espagne a osé briser le consensus en refusant de suivre cette fuite en avant : pas de hausse militaire à 5 %, pas de commande de F-35 américains. Madrid fait le pari qu’une alternative existe, fondée sur une industrie de défense européenne et sur l’autonomie stratégique. Est-ce une posture isolée et irresponsable, ou un signal avant-coureur d’un basculement stratégique ? L’avenir le dira, ou plutôt, les autres pays européens le diront en soutenant ou non la position espagnole.
Les États-Unis taxent, l’Europe s’incline
Deuxième épisode : l’accord commercial avec les États-Unis signé mi-aout dans un cadre surréaliste – un terrain de golf appartenant au Président américain.
Après des mois de négociations, l’UE a concédé à Washington 15 % de droits de douane sur les produits européens. Non seulement cette concession s’est faite sans aucune réciprocité, mais les Européens ont même supprimé leurs propres droits de douane sur les produits industriels américains.
Première puissance commerciale mondiale sur le papier, l’Europe s’est révélée impuissante en pratique, sclérosée par ses divisions internes. Mais, comme trop souvent, ses divisions internes ont pesé plus lourd que sa puissance potentielle. Les Allemands, tétanisés à l’idée de droits de douane encore plus élevés notamment sur le secteur automobile, ont poussé à l’accord. Les Français, eux, ont dénoncé le résultat a posteriori tout en sachant pertinemment ce qui se négociait. La vérité : personne n’a osé prendre le risque de l’affrontement.
Cet accord illustre à la perfection le dilemme européen : trop fragmentée pour parler d’une seule voix, trop dépendante de ses champions nationaux pour penser à long terme, l’UE se prive de la seule arme où elle excelle — son poids économique.
Ironie de l’histoire : une cour fédérale américaine vient de retoquer une partie importante des taxes imposées par Donald Trump. Si cette décision est confirmée par la Cour Suprême, l’Europe aura donc concédé sous la contrainte ce qu’elle aurait peut-être pu obtenir par la fermeté et le droit.
Et que dire de l’Ukraine ?
Tandis que les présidents américain et russe se rencontraient seuls en Alaska, les Européens restaient spectateurs. Deux grandes puissances discutant de la paix et de la guerre sur le continent européen, sans l’Europe. La symbolique, comme la réalité, sont implacables.
Certes, une délégation européenne a ensuite été reçue à Washington. Mais qu’en est-il ressorti ? Rien de concret. Les bombardements russes continuent. Les « garanties de sécurité » promises à Kiev par Donald Trump restent floues. Moscou a répété qu’elle n’acceptera aucun soldat européen pour garantir la paix. Et la coalition des volontaires, censée incarner la solidarité européenne, demeure embryonnaire, sans véritable contenu.
Le constat est cruel : les Européens, pourtant les plus concernés par la guerre en Ukraine, ne pèsent pas dans la recherche d’une solution. Non pas faute de moyens, mais faute d’unité et de vision stratégique.
Faut-il s’habituer à cette marginalisation ?
Non. Mais il faut avoir le courage du rapport de force. L’Europe doit sortir du réflexe de dépendance, s’unir, et assumer enfin une stratégie de puissance.
Or, cet été a révélé une constante : les 27 États membres n’ont pas de stratégie collective. Ils réagissent aux événements, négocient au cas par cas, cèdent pour éviter la crise immédiate, mais ne définissent jamais une ligne directrice de long terme. C’est la marque des puissances secondaires.
L’exemple espagnol montre qu’une autre voie existe : privilégier une industrie de défense européenne, investir dans l’autonomie stratégique, refuser de se laisser dicter ses choix par Washington. Certains y verront une rupture de solidarité. Mais n’est-ce pas précisément l’absence d’une vraie stratégie commune qui menace la solidarité européenne ?
L’histoire nous offre un avertissement. Après 1919, la Société des Nations voulait incarner la paix et la coopération internationale. Mais sans véritable pouvoir coercitif, sans leadership clair, et minée par les divisions entre ses membres, elle s’est révélée impuissante face aux appétits des grandes puissances. L’impuissance de la SdN a ouvert la voie aux tragédies des années 1930.
Bien sûr, l’Union européenne n’est pas la SdN. Elle dispose d’institutions solides, d’un marché intégré, d’une monnaie commune. Mais sur le plan géopolitique, la comparaison devient troublante : comme la SdN hier, l’Europe risque de devenir un forum bavard, incapable d’agir, marginalisé dans les décisions qui comptent, spectatrice des rapports de force qui façonnent son avenir.
Pour s’extraire de l’impuissance, les Européens doivent rompre avec leur réflexe de dépendance et accepter d’entrer dans une logique de rapports de force. Car c’est bien ce langage-là que parlent Donald Trump, Vladimir Poutine ou Xi Jinping. Mais la liste ne s’arrête pas là : Recep Tayyip Erdogan (Turquie), Benyamin Netanyahou (Israël), Mohammed ben Salmane (Arabie Saoudite) ou encore Abdelmadjid Tebboune (Algérie) l’utilisent tout autant.
Qu’on le déplore ou non, la scène internationale est redevenue un théâtre de puissances. L’été 2025 nous met face à une alternative : subir ce nouvel ordre brutal ou apprendre à en maîtriser les codes pour redevenir un acteur respecté et surtout, protéger notre continent et ses habitants. Faute de quoi, l’Europe sera condamnée à n’être qu’un terrain de jeu pour les autres.
Joséphine Staron
Directrice des études et des relations internationales de Synopia