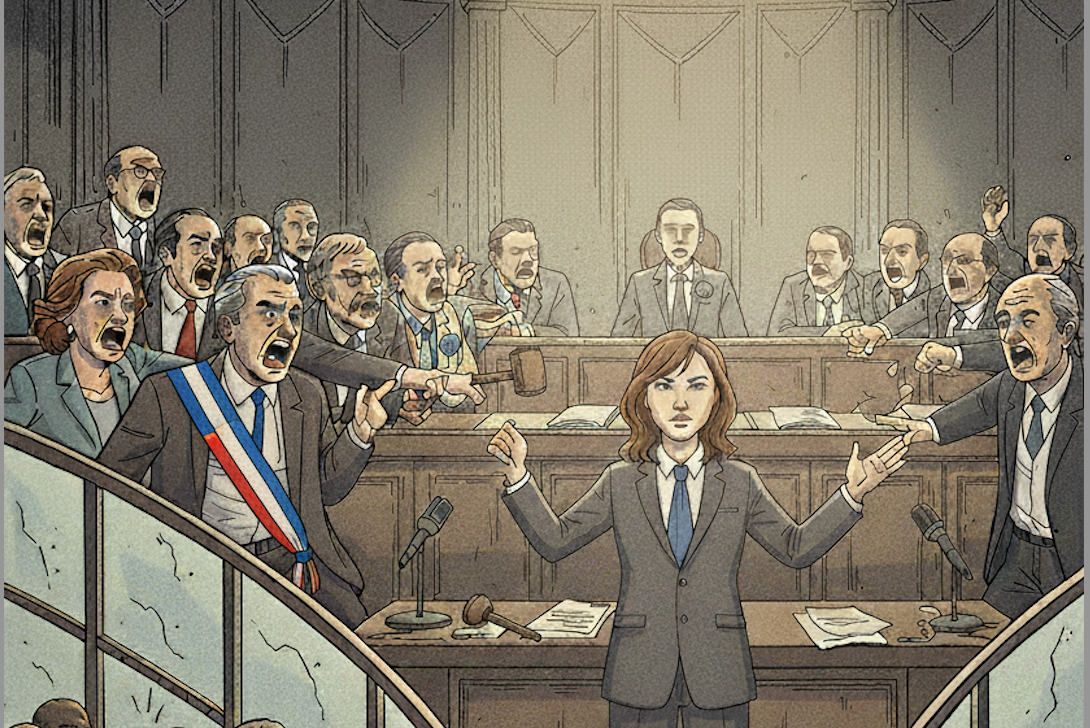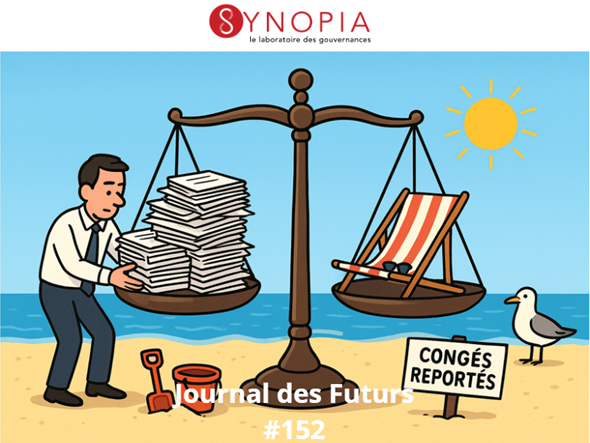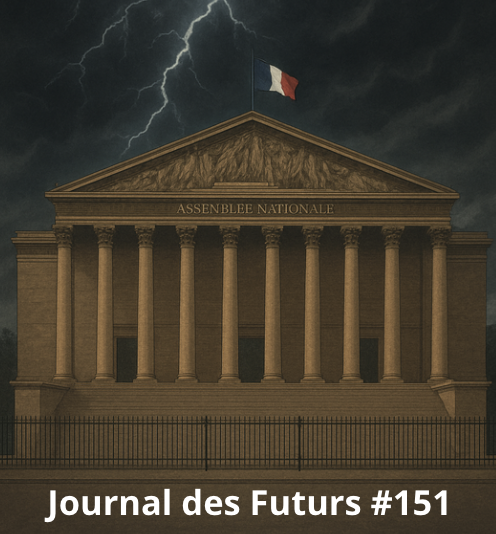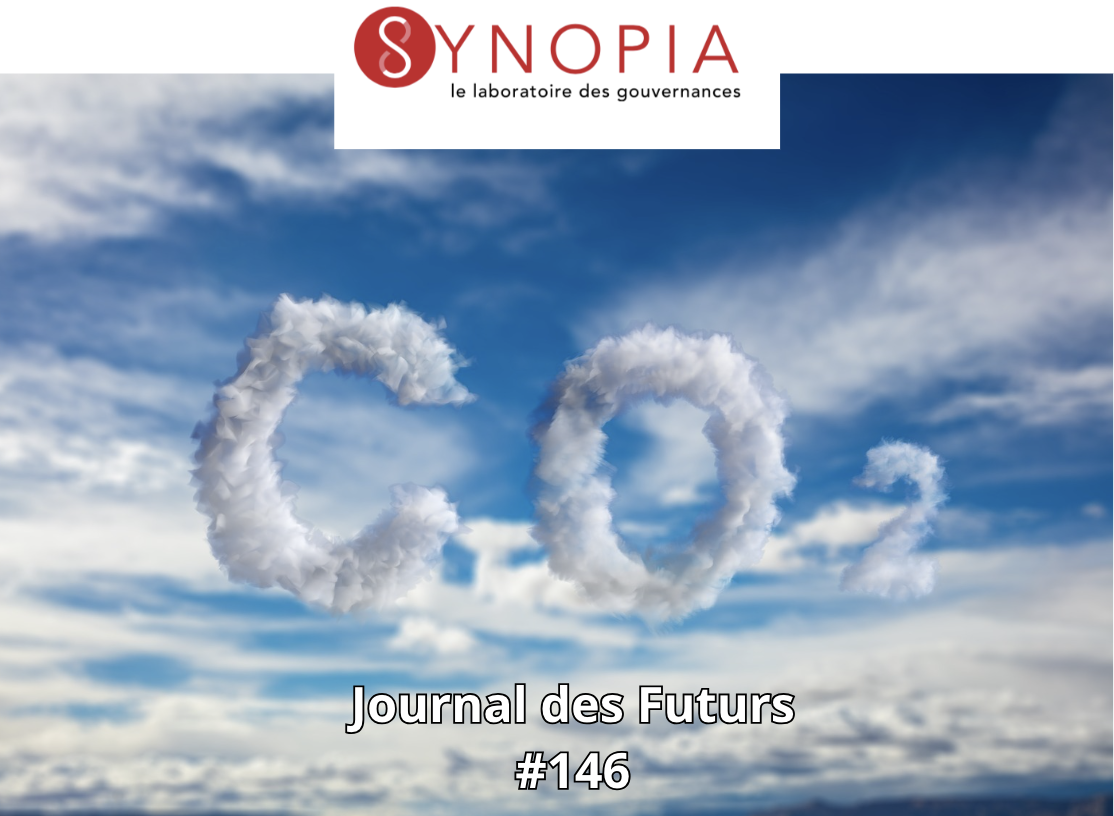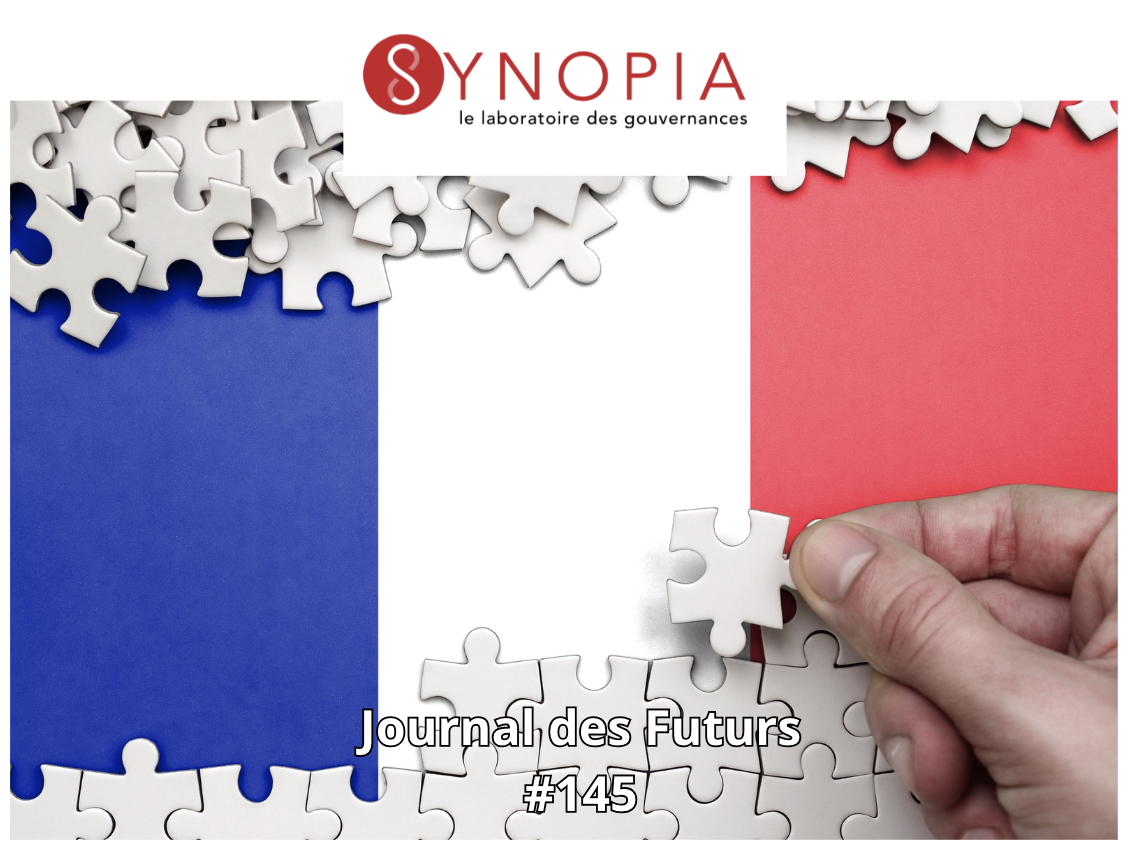La France ne sera jamais le paradis de la justice fiscale ! Et aucun pays d’ailleurs…
par Alexandre Malafaye, Président de Synopia.
La chimère de la justice fiscale parfaite
Le concept de « justice fiscale » relève du mythe. Le paradis de la justice fiscale, c’est l’enfer économique garanti. Aucun pays n’est parvenu à instaurer une égalité absolue devant l’impôt sans provoquer des désastres. Les expériences radicales du XXe siècle – URSS, Chine maoïste, Cuba castriste – ont toutes échoué à créer un paradis égalitaire durable. La Chine et la Russie en ont tiré les leçons. Derrière l’utopie fiscale se profilent souvent la pénurie, la fuite des talents ou la nomenklatura privilégiée. Les faits sont têtus : pas plus la France qu’une autre nation ne trouvera la martingale de la justice fiscale. Et prétendre le contraire, c’est courir après une chimère dangereuse.
Le piège des mots
Car les mots ont un pouvoir. Quand on parle de « justice fiscale », on évoque une idée séduisante sur le plan électoral : celle d’un système parfaitement juste qui corrigerait tous les écarts et réparerait les inégalités, et qu’il suffirait d’une ferme volonté politique pour le faire advenir. Mais ces mots sont piégés et entretiennent cette passion française pour l’égalité.
Le problème vient en grande partie de nos débats politiques de plus en plus hystérisés et polarisés qui font de cette promesse impossible un fonds de commerce électoral. Et ça fonctionne. Une grande partie de la population en vient à croire que la France pourrait devenir le pays de la justice fiscale. Cette croyance crée une attente démesurée, à laquelle personne ne pourra répondre, sauf par leurres ou des gadgets qui ne font que repousser les vrais débat sur la remise en plat de la fiscalité dans son ensemble, ce qui fabriquera encore plus de déception, de défiance et de colère. Il en va de même pour notre modèle social qui mériterait d’être repensé de fond en comble.
Une classe politique déboussolée et des boucs émissaires
Le débat budgétaire auquel nous assistons montre une classe politique peu au fait des réalités économiques et focalisées par deux obsessions qui s’entremêlent pour le pire : le besoin de remplir des caisses publiques exsangues « quoi qu’il coûte » et préparer les présidentielles de 2027. À l’Assemblée nationale, les propositions s’enchaînent pour surtaxer les hauts revenus et les grandes fortunes. Sous couvert de « justice », on multiplie les signaux d’hostilité à l’entreprenariat, sans jamais s’interroger sur les conséquences économiques et on masque ainsi avantageusement des décennies d’errements budgétaires. On agite les symboles, on désigne des boucs émissaires et on traite à la hâte quelques symptômes sans soigner le mal :
la complexité de l’État, la dépense publique mal pilotée, l’abus normatif, l’incapacité à transformer nos administrations, les freins à la réindustrialisation et à la reconquête de notre souveraineté.
Fiscalité record, redistribution massive… et impasses budgétaires
Et parmi ces freins, avant même ce nouveau budget, le record français pour les prélèvements obligatoires : 44 % du PIB, contre 34 % en moyenne dans l’OCDE. Cette ponction colossale finance une redistribution qui mériterait un peu plus de considération à l’égard de ceux qui y contribuent. En 2020, selon l’Insee, la redistribution a augmenté de 74 % le niveau de vie des 20 % les plus modestes et réduit de 21 % celui des 20 % les plus aisés. Après impôts et prestations, l’écart de revenu entre les 10 % les plus riches et les 10 % les plus pauvres passe de 1 à 22,8 à 1 à 5,6.
Ces chiffres montrent que la France pratique déjà l’une des redistributions les plus efficaces au monde. Pourtant, le sentiment d’injustice persiste et voilà maintenant ce nouvel impôt sur les « ultra-riches » proposé par des économistes militants – et censé tout résoudre en faisant rentrer « les plus riches dans la solidarité nationale à laquelle ils ne participent pas » (G. Zucman).
Un impôt de plus… mais aucun projet d’avenir
Cette logique est d’autant plus dangereuse qu’elle ne s’accompagne d’aucune vision. On alourdit la fiscalité, mais sans projet mobilisateur. Cette politique fiscale de gribouille n’apporte pas un euro de plus pour construire des logements, améliorer l’éducation, moderniser l’hôpital ou investir dans l’IA et la défense, ni même pour relancer l’industrie. On pressurise la vache à lait sans l’engraisser, et tant pis si elle maigrit où décide d’aller brouter ailleurs.
Ce n’est pas cette politique fiscale qui motivera les investisseurs, ni qui encouragera les Français à investir dans l’économie réelle. À force de taxer et encore taxer, on paralyse ou on fait fuir les talents et les capitaux, en oubliant de regarder ce que réalisent nos grands compétiteurs, comme les Américains. Déjà, Stellantis investit 13 milliards de dollars aux États-Unis, Sanofi plus de 20 milliards : preuve que notre environnement fiscal et réglementaire dissuade l’investissement productif. Les risques d’une fiscalité excessive sont pourtant connus mais non, nous préférons les ignorer.
Pourtant, les faits sont accablants. Sur les 1 529 grands projets industriels mondiaux recensés depuis 2016, la France n’en a capté que 0,2 %. Dans le même temps, les États-Unis et la Chine multiplient les plans d’incitation et les subventions massives pour rapatrier la production. Quant à l’Allemagne, elle s’organise à grand renfort de moyens, et nous allons le sentir passer.
Se poser enfin les bonnes questions !
Au lieu de phosphorer sur la fiscalité, nos parlementaires devraient s’interroger sur un grand paradoxe : la France est un pays au sein duquel l’épargne des ménages reste très élevée — le taux d’épargne s’est établi à 18,8 % du revenu disponible brut au 1er trimestre 2025, un niveau record depuis les années 1970. Par ailleurs, la France figure parmi les premières nations au monde pour le nombre de millionnaires : 2,868 millions de personnes classées « millionnaires en dollars » en 2023 selon UBS, plaçant ainsi le pays au 4e rang mondial. Et pourtant l’économie reste atone. Mais les agences de notation comme nos créanciers ne s’y trompent pas : la France est un pays riche qui pourra rembourser ses dettes ou a minima, payer les intérêts sans difficulté – la France sait lever des impôts !
Mais si l’épargne est abondante et que les millionnaires sont nombreux, ne serait-il pas plus judicieux de mettre en œuvre des politiques publiques qui créent de la confiance et non de la prudence, qui incitent à la prise de risques et non au conservatisme ?
Il y a du travail car l’état des lieux n’est guère réjouissant. À tous ceux qui veulent investir, la France offre un cadre politique hautement instable et polarisé couplé à un système législatif et réglementaire parmi les plus rigides au monde, des procédures bien trop longues, un foncier industriel qui s’apparente davantage à un champ de mines pour les investisseurs, une défiance culturelle à l’égard de l’économie et des chefs d’entreprises, une approche trop souvent punitive ou déconnectée de l’écologie, un référentiel de pensée politico-étatique qui fait du contrôle tous azimuts et des prélèvements obligatoires le fil rouge de ses politiques, etc.
Si la France en entend réellement sortir de cette trajectoire qui conduit inexorablement au déclin, elle devra réagir sans plus tarder. Tant que nous ne réussirons pas à réconcilier justice et efficacité, fiscalité et attractivité, notre « cher vieux pays » restera un territoire économiquement inquiétant. Cette évidence semble avoir échappé à nos législateurs.
Changer de cap et donner du sens
Le véritable enjeu n’est pas de savoir QUI paye combien et si c’est juste, mais POUR QUOI on paye : pour quelle vision, pour quelle politique, pour quel avenir. Tant que la fiscalité servira à combler des déficits plutôt qu’à préparer l’avenir, la France se fera dépasser par ses concurrents et renforcera encore ses dépendances. Il ne suffit pas de lever l’impôt ; encore faut-il donner du sens aux efforts des Français, pour motiver, pour fabriquer du consentement, pour que l’impôt soit considéré comme un investissement. À trop vouloir rendre le système parfait, on le rend stérile. Il y a 2000 ans, Cicéron disait « excès de justice, excès d’injustice ». A méditer !
Alexandre Malafaye
Président de Synopia.