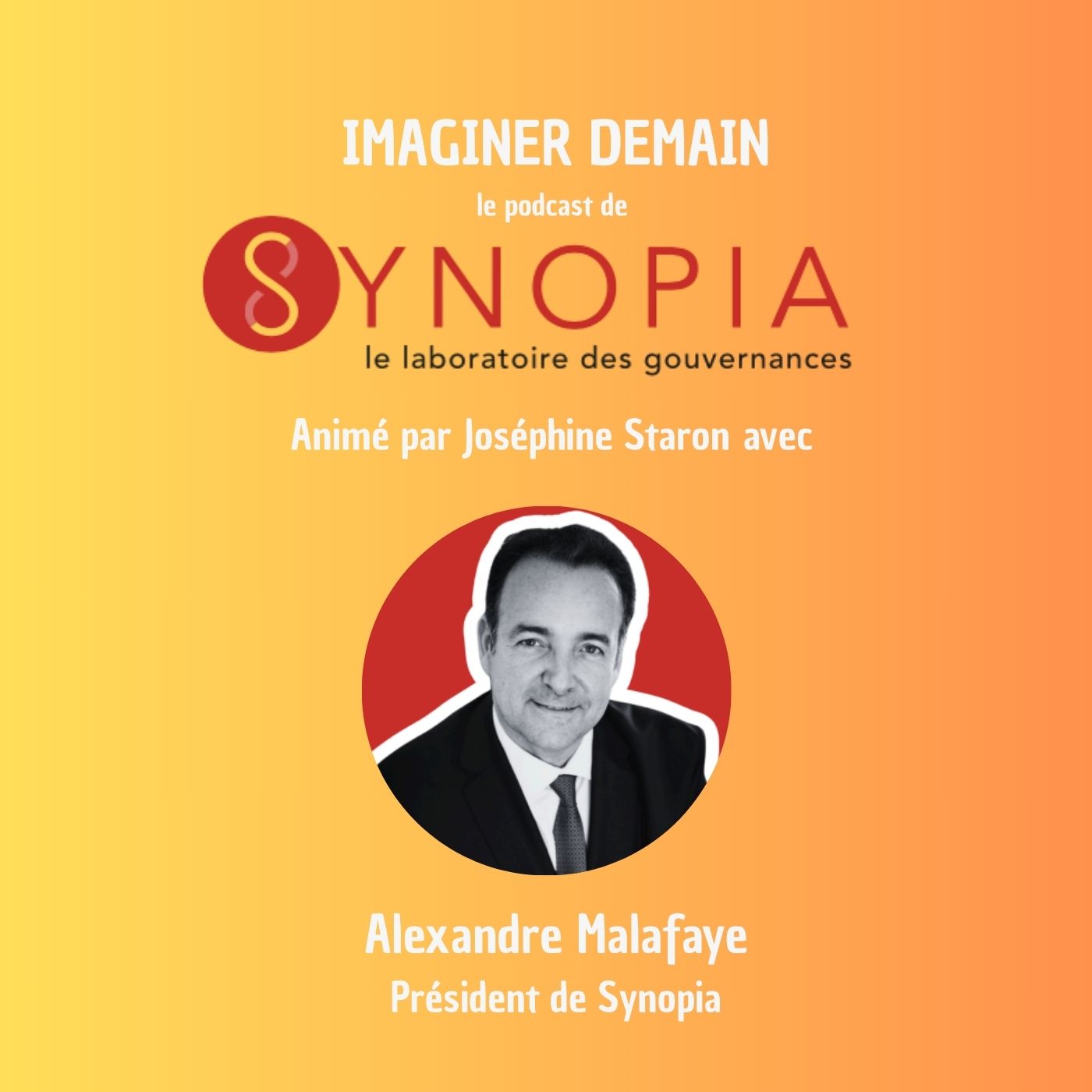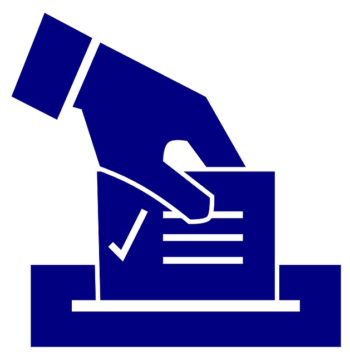2023 fut un long calvaire, marqué par un interminable bras de fer avec les autorités putschistes de Niamey et une rupture radicale avec le Niger. Le cauchemar s’est poursuivi en 2024 avec l’humiliation d’un départ imposé des troupes françaises du Sénégal et du Tchad. En 2025, les premières séquences sur fond de petites phrases et de grandes maladresses, ne laissent guère présager de lendemains meilleurs.
Ce jeudi 30 janvier 2025, le dernier avion militaire français décolle de N’Djamena. La base était installée au cœur de la capitale depuis plusieurs décennies et la présence militaire française au Tchad remontait à l’année 1900. Dans un discours prononcé le jour suivant, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno affiche une fierté qu’il qualifie de « réelle, profonde et légitime ». Il a beau jeu de saluer son partenaire français pour un départ dans « le calme et la sérénité ». Au passage, il ne manque pas de rappeler que lui et lui seul a fixé les nouvelles règles du jeu : la décision de retrait et les délais, imposés de manière unilatérale à une France en perte de vitesse.
Ce jour-là, celui que l’on rebaptise Kaka a décidé d’y mettre les formes. Et pourtant, c’est bien à lui qu’Emmanuel Macron pense lorsque le 6 janvier, devant la conférence des Ambassadeurs, le président français se lâche : « L’ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c’est une maladie non transmissible à l’homme »
Au Tchad, rien ne s’est effectivement passé comme prévu. 10 mois plus tôt, l’envoyé personnel du président français pour l’Afrique en déplacement à N’Djamena, était catégorique pour affirmer que l’armée française resterait au Tchad. Jean-Marie Bockel l’affirmait sur la base de discussions au plus haut niveau. Il n’hésitait pas à afficher « l’admiration » de la France envers la manière dont le président tchadien conduisait le processus de transition, un président qui avait été adoubé par son homologue français le 20 avril 2021. Emmanuel Macron avait à l’époque sciemment assumé le risque de conforter l’accusation d’un double standard face aux juntes militaires. Il n’en a retiré aucun bénéfice.
Alors soudain, le président s’abandonne. Soudain la rancœur, la colère, la déception, prennent le pas sur le langage diplomatique…
Le 6 janvier, Emmanuel Macron exprime publiquement ce qu’il ressent au plus profond de lui-même, cette exaspération devant le double langage, devant l’instrumentalisation d’un sentiment anti-français qu’il ne maitrise pas, devant un manque de fiabilité de certains de ses interlocuteurs sur le continent, devant une situation qui lui échappe chaque jour un peu plus, lui né après les indépendances et qui rêvait d’inventer un « nouveau partenariat », une relation assainie entre la France et l’Afrique.
Les mots prononcés en 2017 à Ouagadougou ont été suivis d’actes concrets. Après le rapport Duclert sur le Rwanda en 2021, Emmanuel Macron a ainsi ouvert le dossier du rôle de la France dans la répression des mouvements indépendantistes au Cameroun de 1945 à 1971. Le rapport de l’historienne française Karine Ramondy et de l’artiste camerounais Blick Bassy, publié ce 28 janvier, pointe « la violence extrême » de la répression française. Cette nouvelle initiative mémorielle se veut une nouvelle démarche de reconnaissance et de réconciliation.
Au fil des ans, Emmanuel Macron fait sa part du chemin mais il découvre à ses dépens que l’on ne fait pas facilement table rase du passé.
Alors, ce 6 janvier, pendant huit minutes il se détache de son texte initial. Huit minutes seulement sur près d’une heure 40 d’intervention, les huit minutes que l’on retient. Les mots claquent : « Je crois que l’on a oublié de nous dire merci. C’est pas grave, ça viendra avec le temps… Je le dis à tous les chefs de l’Etat africains qui n’ont pas eu le courage de le porter : aucun d’entre eux ne serait aujourd’hui avec un pays souverain si l’armée française ne s’était pas déployée dans cette région ».
Sur le départ des troupes françaises du continent, il assène : « Nous avons proposé aux chefs d’Etat africains de réorganiser notre présence. Comme on a été polis, on leur a laissé la primauté de l’annonce. Mais ne vous y trompez pas, parfois il a fallu les pousser ».
Comme cela était prévisible, l’effet boomerang est immédiat.
Le Premier Ministre sénégalais, Ousmane Sonko, dégaine le premier. Il rappelle que le départ des troupes françaises de son pays « découle de sa seule souveraineté, en tant que pays libre, indépendant et souverain ». Et celui qui est aussi président du PASTEF d’enfoncer le clou : « si les soldats africains, quelquefois mobilisés de force, maltraités et finalement trahis ne s’étaient pas déployés lors de la deuxième guerre mondiale pour défendre la France, celle-ci serait, peut-être aujourd’hui encore, allemande ».
Le gouvernement tchadien lui emboite le pas et dénonce, dans un communiqué de son ministre des affaires étrangères « une attitude méprisante à l’égard de l’Afrique et des Africains ».
La sortie sans nuances du président Macron pose une double question : celle de la vérité historique et celle de l’opportunité politique. Emmanuel Macron évoque en réalité deux sujets totalement différents : celui des conditions du départ de Barkhane des Etats du Sahel et celui de la quasi-fermeture des bases militaires françaises présentes sur le continent.
Sur le premier point, le départ de Barkhane, son propos s’adresse exclusivement aux trois régimes putschistes du Sahel central, et principalement au Mali, qui a troqué militaires de Bakhane et troupes de la MINUSMA contre les mercenaires de Wagner – Africa Corps. Ces Etats ont-ils oublié de dire merci ? Difficile de ne pas rapprocher les propos d’Emmanuel Macron de ceux de son prédécesseur, prononcés à Bamako en février 2013. François Hollande disait alors : « Monsieur le président du Mali, vous venez de remercier la France à travers ma personne, à travers le gouvernement ici représenté. J’y suis sensible, j’en suis fier. A mon tour d’exprimer au peuple malien toute ma gratitude pour son accueil exceptionnel … Je viens de vivre la journée la plus importante de toute ma vie politique ».
En 2013, le Mali exprimait indéniablement de la reconnaissance envers la France. A juste titre. Les forces de Serval, par leur engagement sur le terrain, ont évité la chute de Bamako entre les mains des djihadistes. Ne pas le reconnaitre, le nier même comme le fait désormais la junte malienne, s’apparente à une forme de révisionnisme inacceptable.
Quelle que soit l’analyse que l’on dresse du maintien de troupes internationales dans la durée, de leur incapacité à juguler le terrorisme djihadiste, les conditions brutales et humiliantes de leur départ et l’oubli volontaire des 58 morts français au Sahel ont heurté une opinion publique hexagonale. Au-delà des ambassadeurs, c’est aussi à elle qu’Emmanuel Macron s’adresse le 6 janvier. Et que dire du procès indécent fait à une France, accusée régulièrement d’alimenter le terrorisme afin de déstabiliser des régimes hostiles ?
Le deuxième point évoqué par le président de la République a trait à la quasi-fermeture des bases militaires françaises. Et là, le chef de l’Etat semble régler des comptes. Il porte pourtant une part de responsabilité dans la brutalité de la rupture.
Emmanuel Macron, faute d’une prise de décision rapide, a mis la France au pied du mur. La fermeture des bases militaires françaises en Afrique était d’évidence une nécessité politique et le chef de l’Etat en avait pleinement conscience. Mais pour avoir laissé du temps au temps, le chef de l’Etat a nourri le sentiment d’une France d’abord sur la défensive, puis sous pression d’une décision imposée et qui prend des allures de rebuffade.
Derrière la réalité et la complexité des faits, au-delà de la colère froide, il est enfin permis de s’interroger sur le choix des mots, l’opportunité d’une communication qui peine à anticiper l’instrumentalisation qui en sera faite. Emmanuel Macron ne peut pas ignorer que lorsqu’il réclame de la reconnaissance, il lui sera objecté le sacrifice des tirailleurs africains et la gestion par la France du massacre de Thiaroye. Il ne peut ignorer que lorsqu’il parle cash, il nourrit l’accusation d’arrogance dont il est de bon ton d’affubler la France de l’autre côté de la méditerranée.
Comment opposer la rationalité aux passions ? Comment revendiquer une approche décomplexée et dépassionnée face au fracas d’un néo panafricanisme revendicatif ? Quelle peut-être la réaction la plus adaptée lorsque la juste revendication de souveraineté est instrumentalisée par de faux intellectuels utilisant le désarroi d’une jeunesse shootée aux réseaux sociaux pour conforter les intérêts de puissances concurrentes et hostiles ? Comment faire pour que le magistère des mots ne remplace pas durablement la capacité d’action ?
Toutes ces questions sont en ce début d’année au cœur d’un rapport d’information de trois élus de la commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat : « Voir l’Afrique dans tous ses Etats ». Les auteurs dénoncent de manière générale une approche trop verticale, des décisions toujours centralisées à l’Elysée. Ronan Le Gleut, Marie-Arlette Carlotti et François Bonneau ont des mots particulièrement sévères lorsqu’ils évoquent la réduction des bases françaises, une réforme qu’ils jugent mal négociée avec les partenaires, dépassée par les événements, et in fine un revers médiatique majeur. Parmi leurs préconisations : ne pas élaborer une politique africaine unique mais continuer à développer des relations multiples avec les pays africains.
C’est paradoxalement le socle de la démarche du chef de l’Etat, résolument engagé dans une approfondissement des liens entre la France et les pays d’Afrique anglophone et lusophone. Avec eux, pas de ressentiments liés à une histoire commune qui comporte ses zones d’ombres ; pas davantage de liens particuliers forgés par cette même histoire. Il est sans doute plus simple d’écrire le présent lorsqu’il n’existe pas de passé. Pour ce qui concerne les autres, les Etats francophones, une nouvelle page s’ouvrira un jour, mais pas en cette année 2025. Lorsqu’on leur pose la question, les dirigeants africains qui risquent un pronostic, formulent tous la même réponse : un futur avec la France redeviendra possible, mais pour cela, il faudra attendre 2027 et que se tourne la page des années Macron.
Geneviève Goëtzinger
Administratrice de Synopia
Présidente de l’agence imaGGe
Ancienne directrice générale de RFI et de Monte Carlo Doualiya
Membre de l’Académie des Sciences d’Outremer