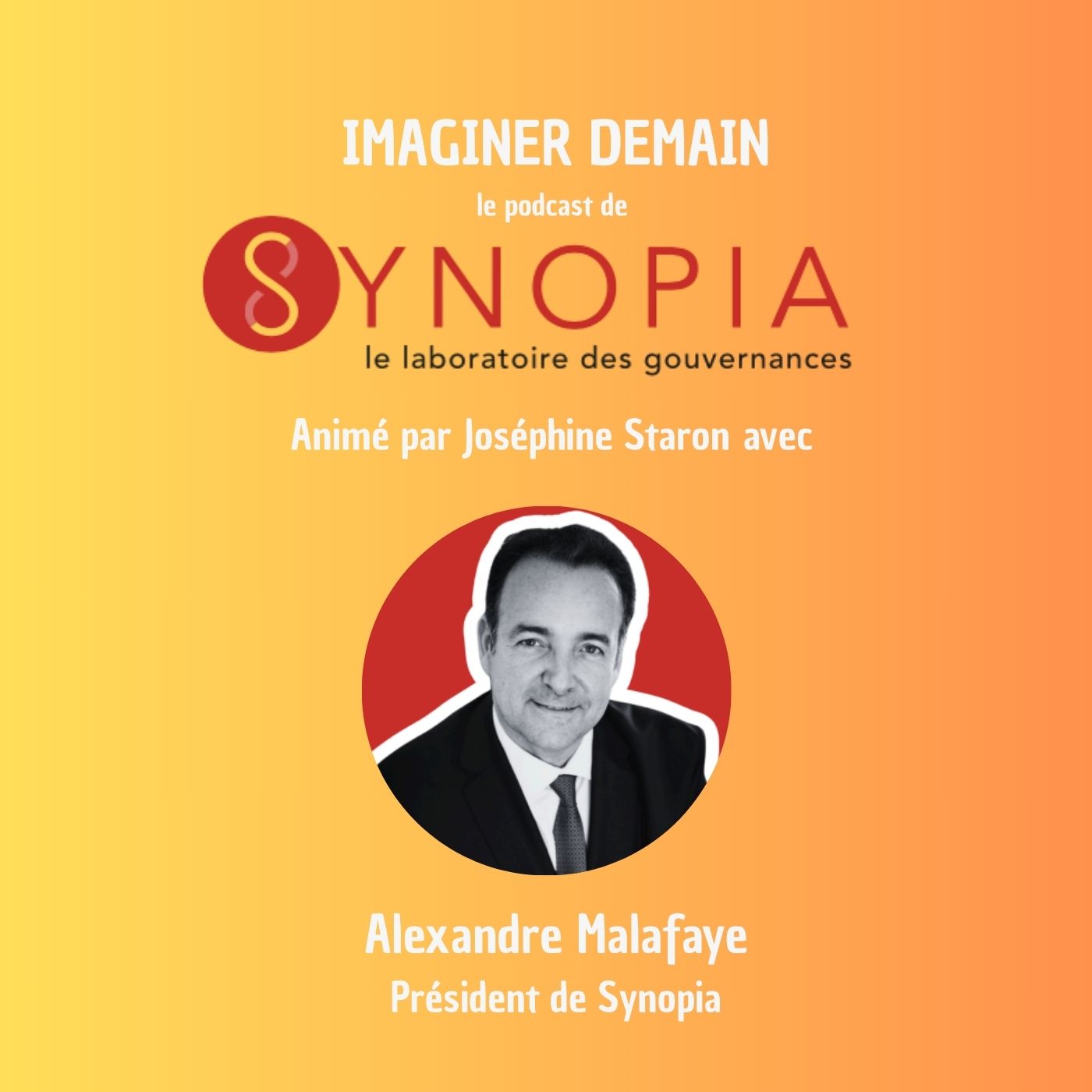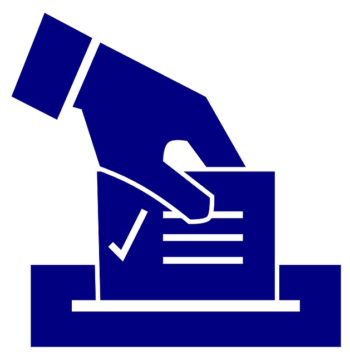Atlantico : Sur France Inter, un agent de l’OFB avait récemment comparé les agriculteurs aux dealers, au motif que les premiers ne voudraient plus les voir sur leurs exploitations. Dans quelle mesure faut-il penser de ce type d’affirmations qu’elles traduisent l’ampleur du “délire” bureaucratique de l’administration française ? Quel portrait peut-on brosser du phénomène ?
Alexandre Malafaye : Je ne parlerais pas de délire. Il y a une frontière très étanche entre le monde public et le monde privé. Cela se traduit par une méconnaissance majeure de ce que représente le monde privé, de son fonctionnement, de ses motivations. Bien souvent, l’administration et même une partie de la classe politique d’ailleurs ne connaissent rien, ou si peu, à l’économie, rien à l’entreprise, considère à tort, dans la grande majorité des cas, que le monde économique est un monde prédateur, que sa seule finalité est de fabriquer de l’argent et de préférence en ne respectant pas les règles. Il faut se garder de généraliser mais cette fracture est bien tangible. L’Etat d’ailleurs a travaillé sur ces questions depuis des années en essayant de créer des concepts tels que le droit à l’erreur, en essayant de donner un certain nombre d’instructions, de façon à ce que les fonctionnaires traitent mieux les administrés, les contribuables, que les rapports avec l’administration soient facilités. Mais il y a encore du chemin à parcourir. L’enjeu majeur est une forme d’acculturation du monde de l’administration et du monde politique aux réalités du monde économique. Ce n’est pas en croyant connaître l’économie en ayant appris des théories de Keynes ou de Friedman et en maniant des tableurs Excel que l’on maîtrise la réalité d’une entreprise et du vécu de l’entrepreneur. L’un des prismes et des problèmes qui expliquent cette espèce de défiance du public vis-à-vis du privé est qu’il y a une tendance à se focaliser sur les grandes entreprises. Cette méfiance à l’égard du monde économique est entretenue par les profits des grands groupes entreprises, aux « nombres magiques » des profits du CAC40. Le monde économique est assimilé au « grand capital », à la spéculation et à la rentabilité des marchés financiers. Or, les grandes entreprises sont quelques centaines en France. Les ETI sont quelques milliers. Et les entreprises à taille humaine sont des millions. Concernant l’incident sur France Inter, il peut apparaître comme choquant que des agents de l’Office français de la biodiversité (OFB) se présentent armés sur une exploitation agricole pour faire des contrôles de fossés ou de tailles de haies. Cela peut aussi s’expliquer parce que leur mission est vaste et que, dans certains cas, ils ne sont pas simplement là pour faire du contrôle administratif. Ces agents sont aussi là pour traquer des fraudeurs, les braconneurs et qui le font parfois en étant armés. Cette méconnaissance est aussi assez répandue dans le monde privé. Il y a une forme de défiance du monde économique qui a l’impression que l’Etat le persécute. Il y a un énorme chantier pour réconcilier le public et le privé. Tout le monde doit comprendre que le pays a besoin des uns et des autres, qu’il y a besoin de l’Etat, de services publics qui fonctionnent mais qu’il y a aussi besoin d’une économie qui soit respectée, qu’elle crée la richesse et que c’est cette richesse qui peut être partagée.
Peut-on dire, selon vous, que l’administration française (ainsi qu’une partie des élus qui gouvernent la France) considèrent la population davantage comme des administrés que comme des citoyens ? Quelles sont les conséquences concrètes de cette situation ?
Luc Gras : L’administration française est très particulière par rapport aux pays européens et au reste du monde. Elle repose sur une centralisation affirmée avec des hiérarchies parfois pesantes mais qui donnent son homogénéité à l’ensemble de l’appareil. En ce sens, le citoyen peut parfois apparaître comme oublié. A l’étranger, l’exemple le plus marquant relatif aux changements d’administrations concerne le “spoil system” aux Etats-Unis. A l’arrivée de chaque nouveau président, comme avec la récente victoire de Donald Trump, cela entraîne le départ de milliers de fonctionnaires d’État, particulièrement 4.000 hauts responsables. La France est dans une toute autre logique. Le facteur temps imprègne l’exercice des administrations françaises. Il ne peut que donner beaucoup de pouvoir aux directeurs d’administrations centrales. À partir de ces considérations objectives, l’administration, qui est particulièrement performante dans notre pays, a tendance à s’imposer aux autres représentations : le personnel politique et les citoyens. Par conséquent, on assiste effectivement à un Etat administratif s’imposant plus ou moins aux administrés. On pourrait parfaitement imaginer une organisation sociétale reposant davantage sur la citoyenneté. Elle supposerait beaucoup plus de concertations avec les Français et d’initiatives relevant des citoyens afin que cela soit pris en compte par l’administration. Ce serait en quelque sorte une participation citoyenne à l’égal de la participation gaulliste dans l’entreprise mais qui, cette fois-ci, trouverait son essor dans la fonction publique.
Alexandre Malafaye : Le problème repose souvent sur la sémantique. De nombreux mots sont attachés et associés aux Français en fonction des circonstances. Le jour du vote, les Français sont des citoyens. Dans la rue, ils sont des citoyens et des individus. Dans les magasins et les commerces, ils deviennent des consommateurs. Dans le cadre des rapports avec l’administration, les Français sont perçus comme des administrés ou des contribuables. Dans les transports en commun, ils deviennent des usagers. A l’hôpital, les Français sont des patients, où bien souvent, la patience est de mise. Derrière tout cela, il y a des narratifs qui se sont complètement enkystés dans l’esprit de la fonction publique et de ses agents. Le vocabulaire en dit long sur leur perception de la population. Et réciproquement. De façon générale, par facilité, le débat politique cultive cette tendance à la catégorisation et se focalise sur des généralités, ce qui est dommageable, car on perd de vue les réalités individuelles et vécues et on bride le débat. Vous êtes un usager donc c’est normal que cela soit comme ça . De la même façon, les données statistiques font l’objet d’un traitement similaire. Des indicateurs ressortent régulièrement comme le taux de chômage ou l’inflation. A chaque fois, ce sont des arbres qui cachent la forêt. Le taux de chômage à 7,5 ou 8 % est mis en avant comme un succès, ainsi que les chiffres de l’inflation, mais derrière cet arbre qui est apparemment beau, il y a une forêt qui raconte une toute autre histoire avec, au niveau de l’inflation, des produits qui auront bien davantageaugmenté et impacté les budgets personnels. Le coût des mutuelles aura explosé. Et le chômage dans certains territoires atteint 30, 40 ou 50 %. Un autre élément explique l’état de colère du pays. En généralisant toute une série de dispositions et de mesures, en confondant vitesse et précipitation en perdant de vue le sens du mot transition, sans jamais penser aux effets et aux réalités, les dirigeants politiques ont perdu de vue les règles essentielles du pilotage du changement. En démocratie, la fabrication du consentement est essentielle, sans quoi, vous risquez des révoltes, ou pire. Nous venons de publier en décembre 2024 un sondage Odoxa pour Mascaret et Synopia1 où l’on constate que 84 % des Français disent subir le changement. Entre 85 et 90 % des Français expliquent qu’ils ne se sentent pas respectés, pas écoutés et pas protégés. Ces scores sont très élevés. Ce problème, qui est considérable, mériterait effectivement plus d’attention. Ces mouvements de colère sont au coeur du débat national et empêchent finalement d’avoir toute forme de débat raisonnable et rationnel pour régler les problèmes en profondeur et avec le temps nécessaire. L’Assemblée nationale en est le triste reflet.
A quel point les rouages de l’administration et l’action des fonctionnaires, particulièrement quand ceux-ci s’entêtent à créer nouvelles normes sur nouvelles normes (sans toujours prendre en compte la compatibilité éventuelle entre celles-ci) peuvent entraîner une déconnexion de fond entre la réalité concrète du pays et celle administrative ? Ne vaudrait-il pas mieux, à certains égards, payer les fonctionnaires à ne « rien faire » ?
Luc Gras : Je ne suis pas sûr que votre humour soit particulièrement apprécié par ces derniers ! Normalement, les fonctionnaires n’ont pas d’initiatives de cette nature. Ils ne font pas oeuvre ni de législation, ni d’autres formes de pouvoir. Néanmoins, dans l’application des textes existants, il existe toujours une marge d’appréciation. Il peut y avoir des pratiques de l’administration qui deviennent quasiment des coutumes au sens juridique du terme, et qui finissent par s’imposer aux citoyens devenus des administrés. Cette situation est à ce moment là très éloignée de cette sorte de pouvoir délégué par le politique à l’administration, court-circuitant par là même les éventuelles initiatives citoyennes à l’origine de l’élection des représentants de la classe politique. Dans un autre sens, n’aurait-on pas intérêt à responsabiliser davantage les fonctionnaires et pourquoi pas à leur accorder des marges d’initiatives dès lors qu’elles seraient prises en faveur du service public ?
Alexandre Malafaye : Il y a deux problèmes majeurs. Le premier concerne l’inscription du principe de précaution dans la Constitution. Au départ, une intention louable mais le principe a été dévoyé. Son champ d’application a été largement étendu. Cela a stérilisé beaucoup de choses. Au nom du principe de précaution, la mise en place de textes de lois, de règles, de normes a été accélérée. Il y a de plus en plus de droits pour de plus en plus de catégories de populations, de types de situations, de types d’activités économiques et sociales. L’état de droit est devenu l’état des droits. Tout est encadré, hyper administré et contrôlé. La France s’en mêle, l’Europe s’en mêle. Tout cela s’empile. Petit à petit, le cadre qui devait permettre aux entreprises d’innover, de créer de la richesse, d’aller de l’avant a été perdu de vue. La fin et les moyens ont été complètement inversés. La norme et le contrôle s’imposent et déterminent la façon dont l’économie doit tourner. Le modèle est devenu étouffant, l’inverse des USA. La directive européenne CSRD sur le reportait extra financier (avec plus de 1000 indicateurs) par exemple est une usine à gaz d’une complexité presque surréaliste. Au niveau de la Commission européenne ou en France en particulier, dès qu’il y a une décision, personne ne se pose la question d’évaluer ce qui existe déjà et de savoir si cela fonctionne ou pas. Il serait judicieux de faire un premier retour d’expérience avant de lancer toute initiative législative ou normative. Et lorsqu’un dispositif normatif ou législatif est envisagé, il n’y a pas de véritables études d’impact ou d’évaluation. Le volontarisme politique, l’idéologie priment sur la réalité. Tout le monde perd de vue le fait que personne ne sait si cela va marcher et si la mesure appliquée produira de bons résultats mais elle est tout de même appliquée. Et les décisions absurdes et les lourdeurs s’empilent, se percutent. Avec l’absence d’évaluation et d’inventaire, personne au plan politique ou administratif ne se rend compte de cette accumulation et de cet enchevêtrement de règles, de normes. Personne ne se pose la question de savoir si cela va produire l’effet attendu. Si les entreprises fonctionnaient comme cela, si elles lançaient leurs produits sans avoir fait d’études de marché, si elles ne tenaient pas compte de leurs consommateurs et de l’économie générale, elles disparaîtraient purement et simplement. Prenons l’exemple des difficultés des agriculteurs face àl’excès de normes. Gabriel Attal alors premier ministre depuis quelques jours découvrait le dossier avec les normes sur les haies dans nos campagnes et promettait de le simplifier. Douze textes différents avaient été imaginés pour de multiples cas, pour une exploitation agricole, sur le bord d’une route, sur une propriété privée, etc.. Sur les fossés, il y a aussi trop de normes. Le nombre d’interlocuteurs différents qui vont s’occuper d’administrer et de gérer les fossés pour les curetages est aberrant. Dans ces domaines, la France est champion du monde, hélas. Cela a eu de lourdes conséquences avec les inondations dans les Hauts-de-France. Les travaux de curetage n’avaient pas été faits ou avaient du retard. Les inondations auraient pu être amoindries en termes d’impact si les fossés avaient été parfaitement entretenus. Une myriade d’agents et d’acteurs se renvoient la balle. Face à une telle complexité, le travail ne peut plus fait dans de bonnes conditions et cela coûte cher. La fabrication de normes insensées et les superpositions de mesures sont un vrai fléau. Il est maintenant «amusant » de constater que tout le monde s’en rend compte, même à Bruxelles. Mais le mal est fait, trop c’est trop, et de plus en plus les Français comme les Européens votent à la façon des Américains, de manière radicale, pour exprimer leur colère et manifester leur existence. Ils veulent être pris en compte, entendus, respectés et que le changement ne soient pas que signe de régression ou de soumission.
Est-il encore possible de changer la matrice intellectuelle technocratique qui prévaut en France ? Qui pourrait mener à bien une telle mission ?
Luc Gras : Si l’on souhaite améliorer les choses, ce qui est toujours un sentiment louable, il est possible de revivifier l’administration. Pour cela, il faudrait la rendre plus attractive par des rémunérations probablement plus différenciées en fonction de l’investissement de chaque fonctionnaire. Il faudrait également ouvrir les possibilités d’initiatives permettant à chaque fonctionnaire d’enrichir sa tâche. Une véritable révolution copernicienne doit être menée. Elle consisterait à ne plus voir un fonctionnaire comme un agent d’État qui n’a pas son mot à dire mais comme un citoyen au service des autres dans le cadre de cet engagement pour le service public.
Alexandre Malafaye : Une révolution est nécessaire pour arriver à cela. Beaucoup d’observateurs qui connaissent bien l’État profond et la France expliquent que notre pays ne s’est transformé qu’au moment où il a touché le point de rupture. Cela s’est malheureusement produit à plusieurs reprises à travers l’histoire de France depuis 1789. Un choc culturel est nécessaire aujourd’hui pour remettre tout cela dans le bon ordre et pour redonner du sens. Tout le monde doit se remettre en question. Cela ne peut pas reposer uniquement sur le volontarisme d’un homme politique. L’exemple qu’il sera intéressant de suivre est celui d’Elon Musk aux États-Unis. Alors qu’il souhaite faire bouger les lignes, quels seront ses résultats ? En Argentine, Javier Milei avait promis qu’il allait utiliser la tronçonneuse pour simplifier et raboter les normes. La encore, il faudra scruter avec attention les résultats de sa politique, sans a priori. La prochaine classe politique qui arrivera aux affaires devra agir et ne pas s’arrêter au stade des promesses, faire du saupoudrage ou entretenir la politique de la fuite en avant. A l’Elysée, au sein du gouvernement et à l’Assemblée nationale, il faut espérer qu’il y aura une un alignement pour enfin changer la donne, faire évoluer les normes. Cela constitue un travail titanesque. Une évolution dans la formation de l’ensemble de la fonction publique doit aussi permettre de redonner du sens. Ce chantier de plusieurs années doit être mené et mis malgré les résistances phénoménales. Le système résiste et de nombreux acteurs sont accrochés à des structures dans lesquelles ils ont un intérêt. Sur le plan de la méthode, bien au-delà des mots et du choc de simplification, pour vraiment transformer le système, il faut s’interroger dans chaque ministère, dans chaque administration et redonner la parole et l’initiative à ceux qui sont dans les administrations. En très grande majorité, les fonctionnaires seraient prêts et contents de faire mieux et autrement. Il faut les associer aux dynamiques de transformation et donner du sens. Cette étape est possible mais cela prendra des années. Sauf si le pays est confronté à une rupture de modèle, à une crise de régime ou de crise systémique. La classe politique doit avoir une farouche détermination pour traiter ces problèmes. Il faut s’occuper du monde agricole, du monde des entreprises. Il faut redonner du sens, retrouver le chemin de l’efficacité, de la croissance et de l’innovation.