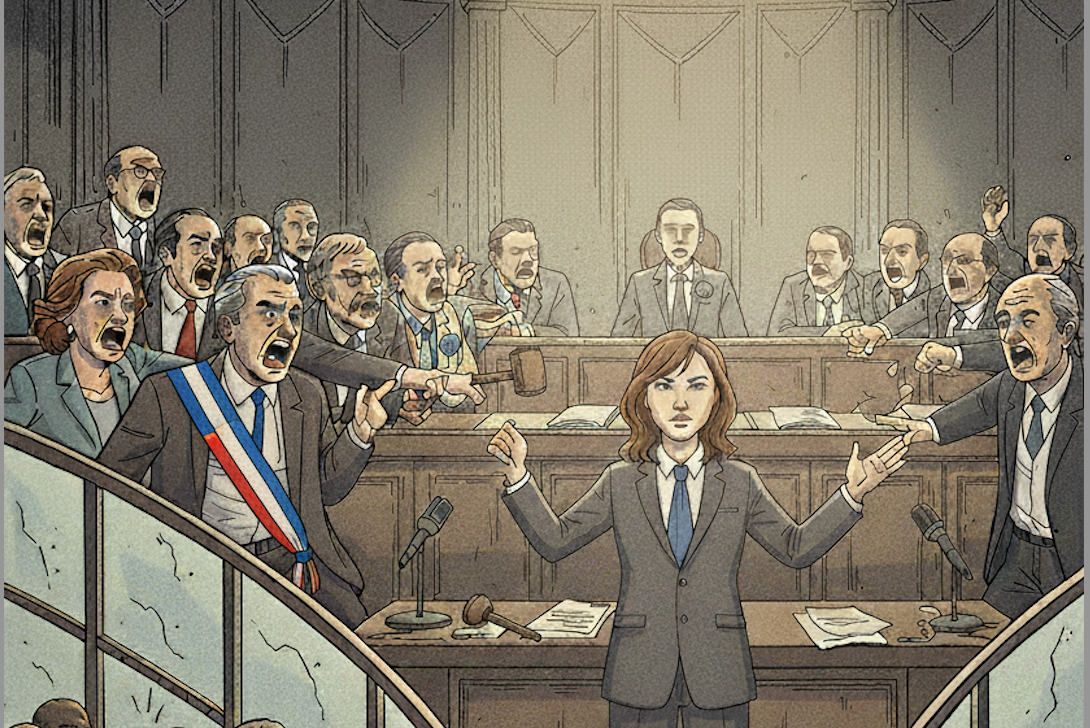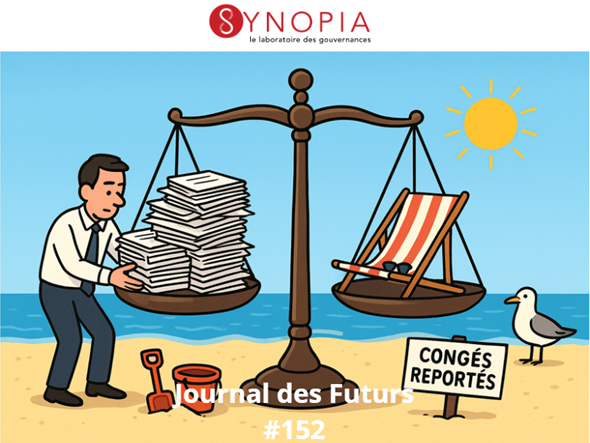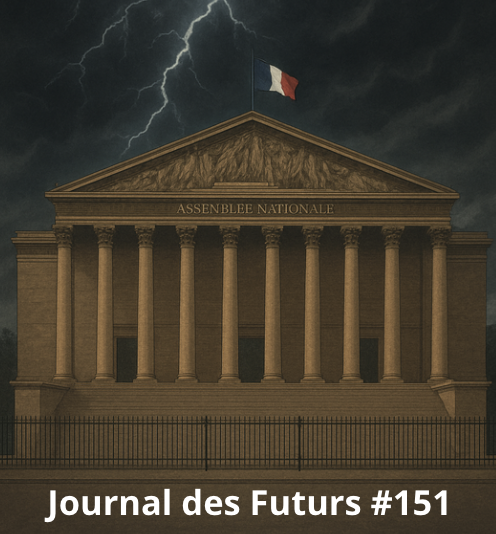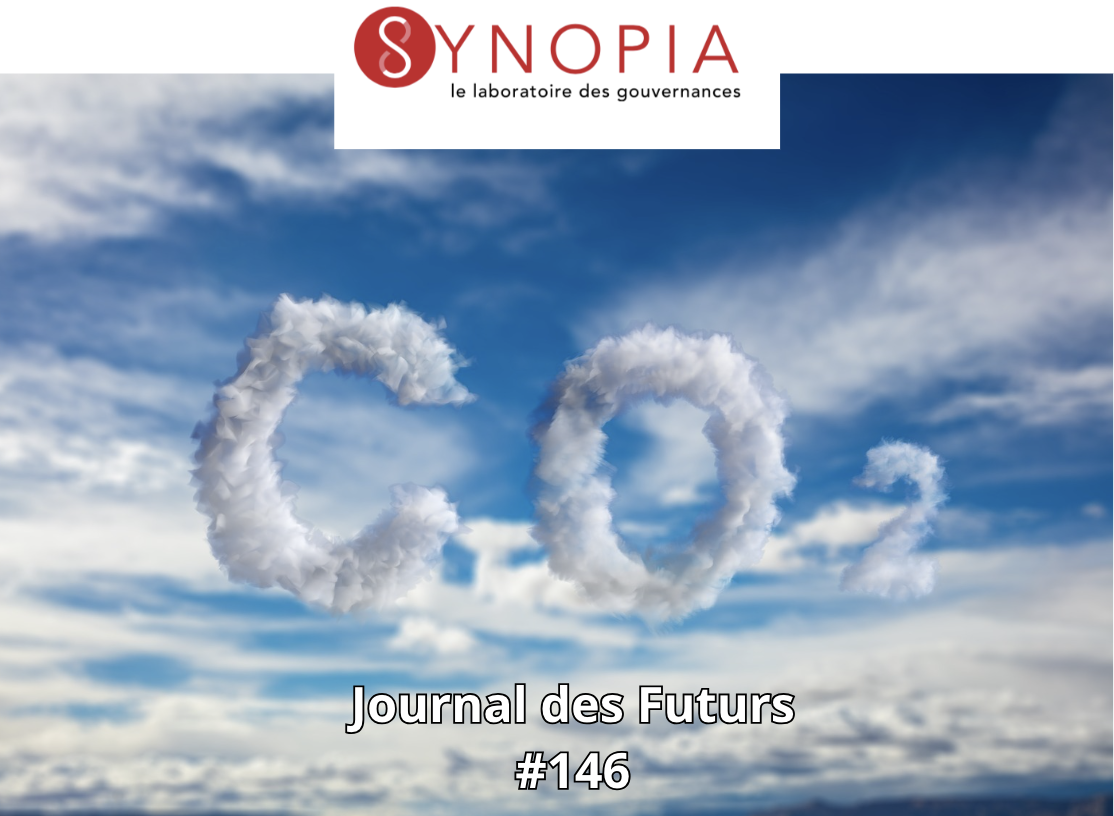Décentralisation : gare au pas en arrière !
par Xavier d’Audregnies, Membre de Synopia.
Au détour d’un entretien avec la presse quotidienne régionale, on apprend qu’une des pistes d’économies que privilégie le nouveau Premier Ministre serait de relancer la décentralisation. Plus exactement, Sébastien Lecornu a annoncé sa volonté de présenter “un grand acte de décentralisation, de clarification et de liberté locale au Parlement”.
Le Premier Ministre a raison de chercher des économies structurelles, et de viser une efficacité accrue de la machine publique, plutôt que de passer un coup de rabot indifférencié sur toutes les dépenses. Cependant, il est curieux de s’attaquer à un tel sujet alors même que le quinquennat est moribond, qu’il n’existe pas de majorité à l’Assemblée, et que le sujet n’a pas fait l’objet d’un débat dans l’opinion lors d’une élection majeure. Il est probable que de cet exercice improvisé ne sortiront que des mesures au mieux cosmétiques ou, au pire, budgétivores.
Car, au fond, après tant de rapports sur le sujet, les solutions sont connues et de deux natures, l’une institutionnelle, l’autre managériale.
La première piste consiste à supprimer deux collectivités territoriales sur les quatre dont nous disposons aujourd’hui (communes, communautés de communes, départements, régions). On peut discuter sur le fait de savoir s’il vaut mieux supprimer la commune ou la communauté de communes, supprimer le département ou la région, mais il faut trancher. C’est le rôle du Parlement de faire cela, ou – pourquoi pas – de soumettre cette question à un référendum. Mais il est certain qu’il faut en supprimer deux.
Cette simplification générerait, à n’en pas douter, des milliards d’économies, tant dans les coûts directs de fonctionnement que dans les coûts d’« entropie » (financements croisés, lourdeur des décisions, réunions entre les différents acteurs, contradictions entre les politiques des uns et des autres, etc.).
La deuxième façon d’économiser de l’argent dans la gouvernance de proximité consiste à remarquer que nombre de décisions des collectivités locales sont des décisions de gestion, et non des décisions relevant de choix politiques. Comment mieux organiser la collecte des ordures ménagères ? Comment le service de crèches peut-il être mieux organisé pour répondre aux besoins des parents, et notamment des familles monoparentales ? Comment organiser un service d’acquisitions foncières de manière à asseoir une politique du logement efficace ? Comment organiser le ramassage scolaire de façon efficiente ? Comment organiser le service de sécurité civile pour mieux faire face aux incendies ? Et ainsi de suite.
La plupart des actions menées par les collectivités locales consistent à fournir des services à la population. Pour en améliorer l’efficacité tout en maîtrisant les coûts, il est préférable d’en confier la gestion à des professionnels plutôt qu’aux élus, même animés de la meilleure volonté. On ne s’improvise pas ingénieur en travaux publics, puéricultrice, expert en transports ou encore chef des pompiers. Le rôle des élus locaux est avant tout politique : définir les priorités (par exemple, favoriser la petite enfance plutôt qu’un foyer pour personnes âgées), désigner les responsables des services concernés et leur donner les moyens d’agir de façon professionnelle. Si ces responsables s’avèrent incompétents, il revient aux élus de les remplacer. Mais ils ne doivent en aucun cas chercher à se substituer aux professionnels. Pourtant, cette confusion des rôles reste fréquente dans la gestion des collectivités territoriales.
D’autant que, très souvent, les marges de manœuvre financières des collectivités territoriales sont utilisées par les exécutifs locaux pour effectuer, soit des dépenses de prestige (on a beaucoup parlé des flamboyants hôtels de région, par exemple), soit des dépenses démagogiques à l’approche d’une élection, soit encore des dépenses de cabinet ou de communication. Tout cela n’améliore en rien le service rendu à l’usager-contribuable-citoyen, qui hurle à longueur d’élections, de blocage sur les ronds-points ou de manifestations spontanées, son besoin de services publics plus performants.
Il existe enfin une troisième source d’économies que tout le monde a en tête mais dont personne ne parle : c’est la nécessité de (re)centraliser certains pans de l’action publique, c’est-à-dire de les rendre à l’État.
Soit pour des raisons d’efficacité opérationnelle : comment comprendre que les services d’incendie soient organisés sur une base départementale, et que les pompiers soient des agents départementaux, alors que, très souvent, l’importance des incendies nécessite de concentrer tous les moyens disponibles, humains et matériels en un même lieu ?
Soit pour des raisons d’égalité des citoyens français : comment comprendre que le RSA soit distribué par les départements, alors qu’il s’agit d’une solidarité nationale ? Comment comprendre que les PMI soient départementalisées, ici généreusement pourvues, là indigentes ? Comment comprendre que les titres d’identité nationale soient délivrés par les communes (certaines oui, d’autres non) ?
Ce dernier sujet est encore tabou. Et pour cause, c’est le même monde politique, qui, dans les provinces, fournit le personnel politique des collectivités (il y a 600 000 élus en France…), et qui, à Paris, vote les lois régissant l’organisation de la gouvernance territoriale. Et le monde politique n’est pas suicidaire !
Il y a là un nœud gordien qui ne peut être tranché que par une majorité neuve disposant d’une forte assise électorale. Ou par un référendum, précédé d’un beau et bon débat démocratique qui mettrait tout sur la table, et qui permettrait de ne dissimuler aucune arrière-pensée. À l’évidence, aujourd’hui, ces conditions ne sont pas réunies pour trancher dans le vif.
Xavier d’Audregnies
Membre de Synopia.