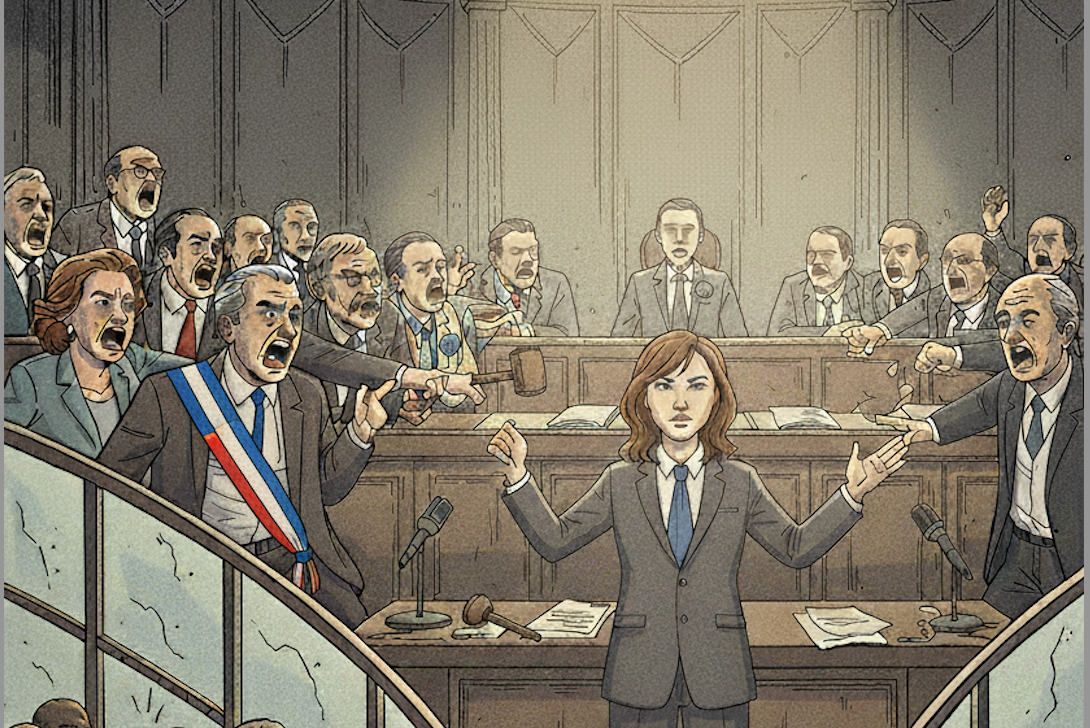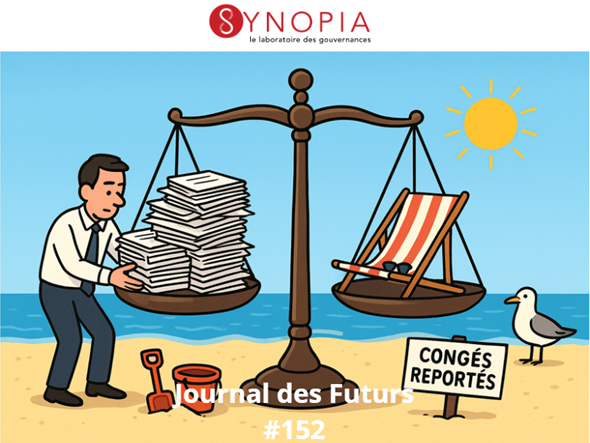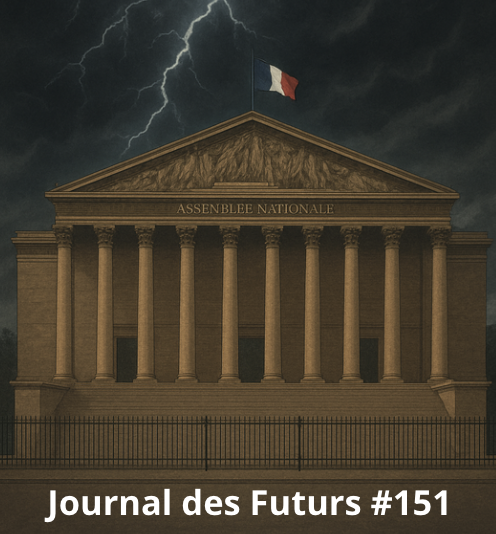La somnambule réveillée : l’Europe doit agir maintenant et correctement ![1]
Dans mon article « Quand les somnambules se réveillent »[2], j’ai souligné l’urgence pour l’Europe de prendre en main sa propre sécurité. En Allemagne, des modifications de la Loi fondamentale ont été récemment adoptées autorisant des déficits budgétaires additionnels au profit de la défense. En même temps, le Conseil de l’Union européenne a approuvé en principe les propositions de la Commission européenne d’allouer plus de 800 milliards d’euros pour la défense de l’Europe.
La question qui se pose désormais est celle de la mise en œuvre efficace de ces mesures dans le cadre d’un horizon à cinq ans. D’autant que cet horizon est marqué par une menace incontestée – si l’on en croit les évaluations de l’OTAN, de nombreux États membres et du BND[3] –, base de travail de la Commission dans son Livre blanc pour une défense européenne « Préparation à l’horizon 2030 », rendu public le 19 mars 2025.
Nous faisons face à un triple défi jusqu’alors inédit : investir des sommes considérables dans la construction d’une capacité de défense européenne, en un temps très court, et ce pour compenser le désengagement des États-Unis au sein de l’OTAN, ce qui n’est plus exclu depuis le 20 janvier 2025.
Aussi limitées que soient les compétences de la Commission européenne en matière de défense et d’armement, elle doit, au vu de l’ampleur des moyens à mobiliser, veiller au respect de certains principes clés : l’additionnalité, la complémentarité, l’interopérabilité, la capacité logistique d’approvisionnement et la disponibilité en temps voulu. Pour garantir l’effectivité de ces principes, un rôle fort de l’Agence européenne de défense (AED) est indispensable, en tant qu’instance de coordination et de supervision. André Loesekrug-Pietri a récemment très bien caractérisé les débats en Europe et dans l’OTAN en écrivant : « 99 % of discussions are about the % of defence spending ». Nous faisons face ici à un réel problème dans nos discussions : elles manquent cruellement de finalité. Autrement dit : les pourcentages ne disent rien sur les effets réalisés, surtout en phase de dégression du PIB.
Additionnalité
Le principe d’additionnalité stipule que les fonds de l’Union européenne ne peuvent être alloués qu’à la condition expresse qu’ils ne viennent pas se substituer aux dépenses publiques structurelles d’un État. Dans le contexte de l’augmentation des dépenses de défense par l’UE, cela signifie que l’assouplissement des critères de Maastricht ou des règles de frein à l’endettement doivent s’accompagner d’une vigilance renforcée. Les marges budgétaires ainsi créées doivent être réservées exclusivement à de véritables investissements militaires visant à renforcer les capacités de défense du continent.
Ce qui importe est une augmentation concrète et vérifiable des capacités, seule à même de contribuer effectivement à la sécurité européenne. Cette augmentation ne peut provenir que d’un surplus de financements, et non d’un simple échange de ressources budgétaires.
Complémentarité
La complémentarité entre les fonds de l’UE et les programmes nationaux de défense – comme le préconise le Livre blanc « Préparation à l’horizon 2030 » – doit être pleinement intégrée dans les planifications. Si le financement par l’UE de la reconstitution des stocks de munitions peut faire débat, l’investissement dans les capacités industrielles nécessaires constitue, lui, un gain stratégique.
L’UE doit concentrer ses moyens sur le renforcement qualitatif des capacités militaires européennes, en comblant les lacunes en matériels des États membres. Ce soutien permettra de faire face au déficit de capacités susceptible d’apparaître en cas de retrait américain.
Interopérabilité
Contrairement à l’US Army, vaste et homogène, les armées européennes souffrent d’une grande disparité d’équipements et de doctrines. Or, les enseignements de la guerre en Ukraine soulignent la nécessité d’un combat interarmes intensifié.
Remédier à cette fragmentation passe par l’acquisition de matériels parfaitement compatibles entre eux et avec les systèmes existants. Aucun compromis ne doit être fait ici, sous peine de retomber dans les travers du passé, comme la multiplication de variantes dans des programmes communs. Le cas du NH-90, avec plus de 20 versions différentes, est un exemple éloquent à ne pas reproduire.
Capacité logistique d’approvisionnement
Garantir l’accès aux matières premières et produits essentiels est crucial. Ce contrôle passe par la maîtrise de la chaîne logistique. Il vaut mieux disposer d’un matériel moins performant mais sous contrôle européen total, plutôt que d’un matériel sophistiqué dont la logistique est incertaine. L’exemple portugais, ayant renoncé à l’achat de F-35 pour ces raisons, en dit long à ce sujet.
Ce principe ne s’oppose pas seulement à certaines importations hors UE, mais aussi aux adaptations nationales qui complexifient inutilement les programmes. Le NH-90, encore une fois, illustre les dérives d’une telle approche. Autre exemple d’un autre ordre mais aux conséquences tout aussi néfastes : le fait que l’Allemagne et la Pologne n’aient pas réussi à se mettre d’accord sur le programme Leopard est, dans le contexte actuel, une faute capitale qu’il faut d’urgence corriger dans le cadre du développement du « char du futur » (MGCS).
Disponibilité en temps voulu
Face à l’urgence, tout ce qui est disponible doit être acquis sans délai. Il est inacceptable que les munitions fournies à l’Ukraine n’aient pas été immédiatement remplacées, comme c’est le cas (entre autres) en Allemagne. Le recours au droit des marchés publics n’est pas une excuse valable dans l’urgence. Le Livre blanc en propose néanmoins à toutes fins utiles une évolution, encore faut-il saisir cette opportunité.
Il est incohérent de faire appel á des financements privés sans être prêt á prendre des risques juridiques dans les procédures de passation de commandes. Parallèlement, les projets de recherche menés sous l’égide des initiatives européennes de défense (EUDIS et HEDI) doivent être accélérés et concrétisés en cas de réussite. Cela implique une utilisation responsable de ce nouvel endettement.
Quel rôle pour l’Europe ?
Il convient de rappeler – comme le fait la Commission européenne – que les besoins militaires doivent être définis dans le cadre des structures de l’UE et de l’OTAN. Les fonds pour y pallier existent dorénavant avec le plan « ReArm Europe ». Il faut maintenant les utiliser de manière responsable.
En l’absence de compétence formelle en matière de défense, l’UE doit redoubler de rigueur dans l’emploi de ses ressources. Ceux qui demandent des contributions financières européennes (ou de nouveaux instruments comme les euro-obligations) doivent en accepter les conditions strictes.
L’UE ne doit pas soutenir certaines ou l’ensemble des approches nationales avec de « l’argent frais », mais uniquement un véritable effort commun. Faute de quoi, elle doit se retirer du financement. En assumant pleinement ce rôle, elle pourra apporter une contribution historique à l’émergence d’un marché intérieur européen de la défense.
Enfin, elle devrait veiller à ce que les projets financés par des fonds européens soient soumis à un contrôle des exportations au niveau européen (et non national), afin d’en tirer aussi des bénéfices économiques et géopolitiques. Avec ces moyens, la Commission européenne pourra inciter les États membres à tout faire pour rechercher une préférence européenne et éviter les exemples funestes précités. Elle peut, de plus, aider à accélérer les programmes multinationaux tout en incitant à les ouvrir aux État membres encore réticents.
Dans le cadre du Plan « ReArm Europe », la Commission européenne a un véritable rôle à jouer. Elle doit s’appuyer sur les États membres concernant la définition des besoins, ainsi que sur l’AED, les services existants – pourquoi créer encore de nouvelles entités ? – et éventuellement des supports externes pour la mise en œuvre, toujours dans le souci de l’efficacité et de la célérité. Ce n’est qu’en gagnant le pari d’une sécurité accrue (et dissuasive !) pour notre Europe que nous pourrons justifier ce nouvel endettement pour les générations suivantes.
Stéphane Beemelmans
Ancien Secrétaire d’État à la Défense en Allemagne
Membre du Conseil d’administration de Synopia
[1] Cet article est la traduction adaptée et augmentée par l’auteur de son article paru le 4 avril 2025 en allemand (https://www.freiheitmachtpolitik.de/essays/die-aufgewachte-schlafwandlerin/).
[2] Stéphane Beemelmans, « When the Sleepwalkers Awaken: A Plea for a New European Security Architecture », Freiheit Macht Politik, 27 février 2025, traduction adaptée et augmentée : « Quand les somnambules se réveillent : plaidoyer allemand pour une nouvelle architecture de sécurité européenne – Point de vue d’un Allemand », Schuman Papers n° 784 du 17 mars 2025.
[3] Bundesnachrichtendienst: l’homologue de la DGSE française.