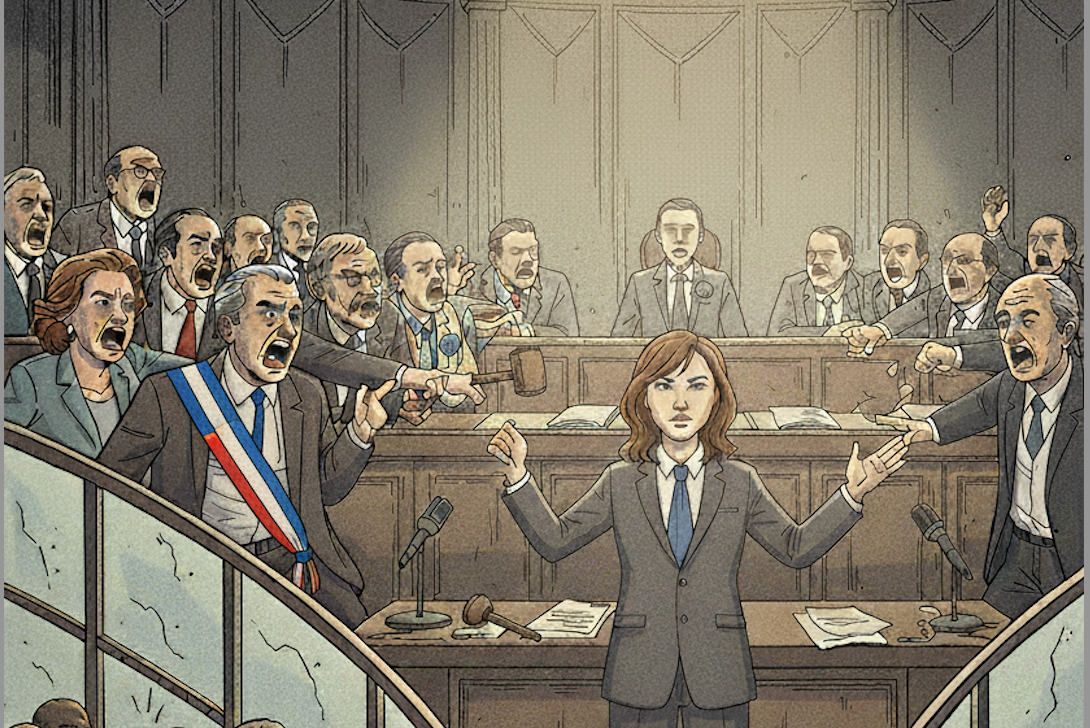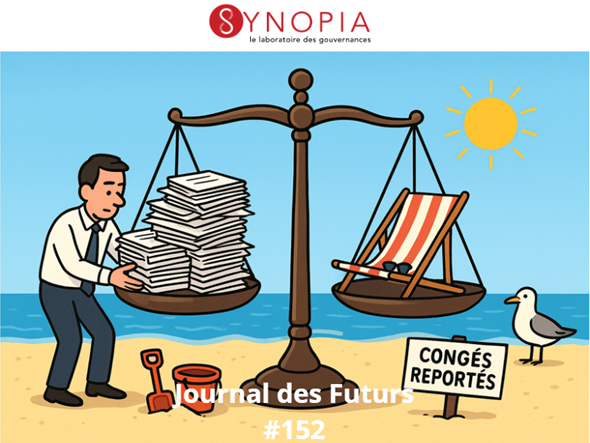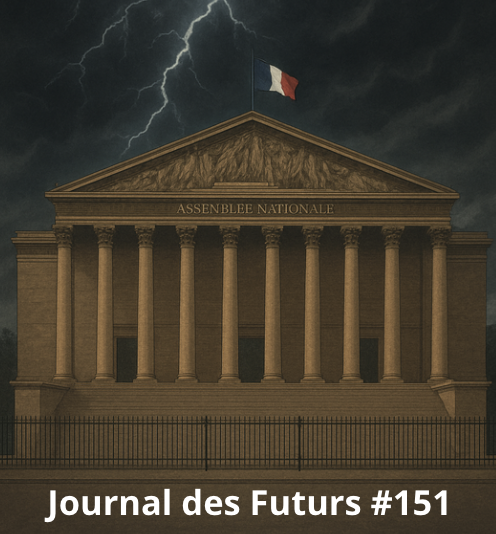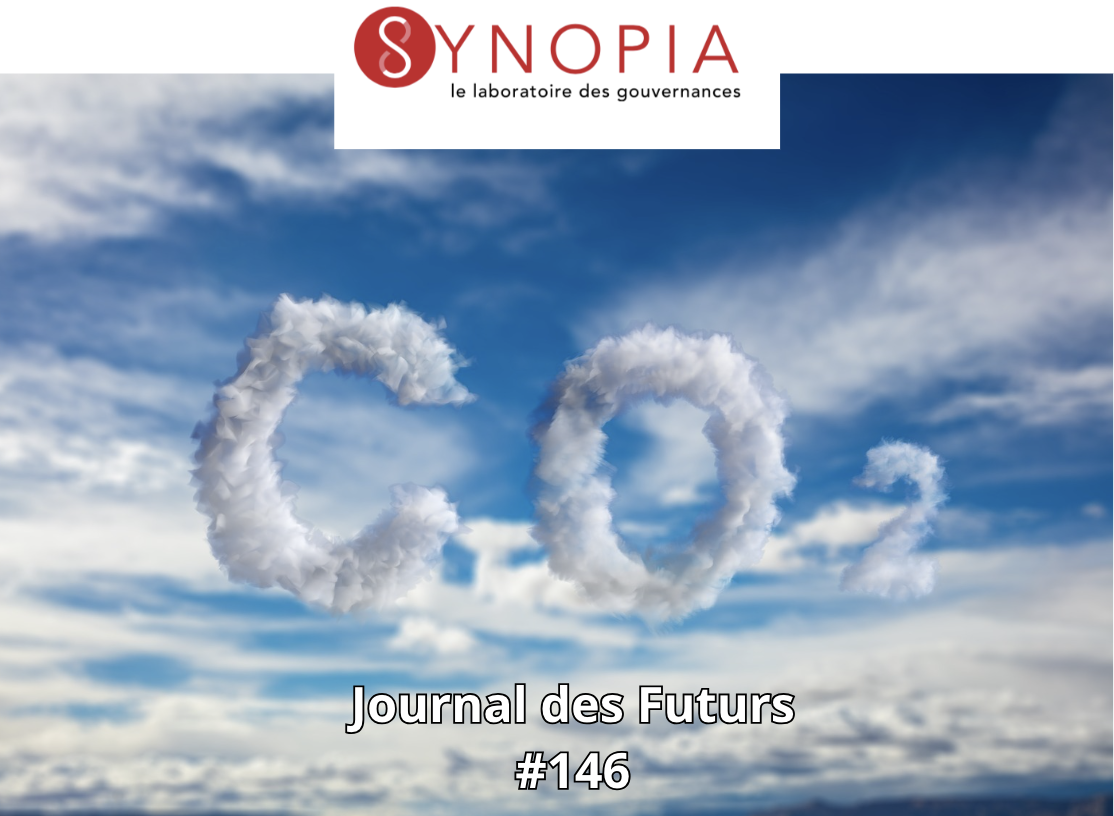Dans son article 9, le Grundgesetz donne le droit à toute personne de fonder des entreprises et des associations et ajoute dans l’article 19 III que celles-ci sont détentrices de tous les droits fondamentaux, sauf s’ils ne sont pas applicables, bien sûr. Sur le plan hiérarchique, le texte laisse ainsi la première place aux droits des hommes et des citoyens, et ce n’est qu’à partir de l’article 20 qu’il va définir l’Etat.
La France, quant à elle, ne mentionne jamais les entreprises dans sa Constitution de 1958 et ne parle d’économie que dans le cadre du Conseil économique, social et environnemental. Il en est fait cependant mention dans l’article 9 du Préambule de la Constitution de 1946 mais uniquement pour engager le processus de nationalisation : « Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. »
Même si le Préambule prétend « proclamer les principes politiques, économiques et sociaux », ceux-ci se rapportent uniquement aux droits des travailleurs, l’entrepreneur ne faisant visiblement pas l’objet d’une attention particulière.
L’Allemagne s’est rebâtie grâce au modèle de l’économie sociale de marché, qui a donné une forte part de responsabilités aux entreprises dans la construction de l’Etat et la reconstruction d’un pays et d’une société détruite par la guerre et l’idéologie nazie
Qu’en découle-t-il pour nos deux pays ?
L’Allemagne, pays divisé en quatre régimes d’occupation, chacun avec leurs différentes conceptions de l’économie, s’est rebâtie grâce au modèle de l’économie sociale de marché, qui a donné une forte part de responsabilités aux entreprises dans la construction de l’Etat et la reconstruction d’un pays et d’une société détruite par la guerre et l’idéologie nazie. Les entreprises ont, ce indépendamment de leur taille, joué ici un rôle primordial longtemps avant que l’Etat fédéral ne soit créé. De là s’est développée une relation Etat-entreprises faite d’un respect et d’un appui mutuel avec des limitations claires dans l’exercice des fonctions respectives.
Du côté de l’Etat, ces limitations produisent deux effets : il ne s’immisce pas (trop) dans les affaires internes des entreprises et en parallèle, il ne s’engage pas massivement dans l’appui à l’exportation, toujours sur le qui-vive par rapport aux réactions des concurrents nationaux les uns vis-à-vis des autres.
De leur côté, les entreprises tiennent à leur indépendance vis-à-vis de l’Etat et attendent de celui-ci un « cadre d’ordre » avec des réglementations claires et raisonnables, sans ingérence dans la conduite des affaires.
Comme ce « cadre d’ordre » est régulièrement sujet à des débats politico-idéologiques, les entreprises (et les syndicats) financent de façon substantielle une multitude d’instituts de recherche économique et de think tanks afin d’être non seulement partie prenante et partie agissante dans la construction de l’Etat et de la société. Rien que pour l’année 2024, les entreprises, associations, ONG, syndicats et églises allemandes ont dépensé plus d’un milliard d’euros pour faire valoir leurs points de vue, défendre leurs intérêts et nourrir le débat politique sur l’économie au seul niveau fédéral.
Au sortir de la guerre, la France a mobilisé ses forces autour d’une grande dynamique politique et sociale, et « en même temps », a fait le choix de collectiviser une part significative de son économie, en nationalisant des entreprises sous les conditions de l’article 9 du Préambule, mais aussi parce qu’elles avaient collaboré
Par comparaison, même si aucun chiffre officiel n’est disponible, le budget global de l’ensemble des think tanks français peut-être estimé à une quarantaine de millions d’euros. Cette réalité a une histoire.
Au sortir de la guerre, la France a mobilisé ses forces autour d’une grande dynamique politique et sociale, et « en même temps », a fait le choix de collectiviser une part significative de son économie, en nationalisant des entreprises sous les conditions de l’article 9 du Préambule, mais aussi parce qu’elles avaient collaboré.
Même si la Constitution française précise d’emblée que le principe de la République est « le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple », le reste du texte est exclusivement axé sur les institutions nationales. L’Etat se place dans la grande tradition de Colbert et ne se contente pas de fixer les règles du jeu : il est ou veut être le régisseur de l’économie, en particulier si elle relève de l’intérêt national. La reconstruction de la France s’est ainsi faite au sortir de la guerre sous l’égide de l’Etat.
Aujourd’hui encore, cette différence d’approche et de culture des relations Etat-entreprises persiste dans nos deux pays et c’est d’autant plus surprenant que dans le contexte de la mondialisation, les grandes entreprises, partout dans le monde, doivent s’adapter à une diversité de régulations et de cultures nationales, souvent éloignées de celles de leur pays d’origine.
Cette différence est encore plus flagrante pour les entreprises françaises et allemandes, qui réalisent l’essentiel de leur chiffre d’affaires au sein de l’Union européenne et au sein de laquelle le cadre réglementaire applicable aux entreprises est désormais largement défini au niveau européen. Dans ce contexte, le recours au lobbying à Bruxelles – et au-delà – s’impose comme une nécessité.
Dans le domaine de la politique étrangère, l’Ifri et son homologue allemand, la DGAP, disposent de budgets globaux comparables, tant en ce qui concerne les subventions publiques que la participation de leurs membres et des entreprises qui soutiennent leurs recherches et activités. Par ailleurs, puisque presque toutes les décisions prises « à Bruxelles » doivent, à un moment ou à un autre, être validées par les gouvernements des Etats membres, il est donc essentiel que le lobbying européen dispose un relais actif dans les capitales nationales.
Et ici aussi, nous constatons une différence notable entre nos deux pays. Si l’intérêt pour un engagement au niveau européen semble comparable, l’implication des entreprises pour réfléchir et façonner l’organisation et la gouvernance de leur propre pays contraste nettement entre la France et l’Allemagne, que ce soit pour les questions intérieures, européennes ou internationales. En 2022, le Medef déclarait entre 1,5 et 1,75 million d’euros de dépenses pour toutes ses activités de lobbying en France, contre 8,8 millions pour son homologue BDI en Allemagne (en 2023).
La puissance d’un pays – nos deux Nations en sont les meilleurs exemples – se forge au niveau international par un alliage de volonté politique allié de puissance économique et le cas échéant, militaire
La puissance d’un pays – nos deux Nations en sont les meilleurs exemples – se forge au niveau international par un alliage de volonté politique allié de puissance économique et le cas échéant, militaire. Là où ces trois conditions ne sont pas réunies en même temps, la puissance devient toute relative et laisse la place à la faiblesse. L’économie et les entreprises ont dans cet agencement une importance capitale pour garantir la solidité de nos démocraties : c’est sur une économie forte que repose le bien commun, c’est grâce à la puissance militaire que celui-ci est défendu, et c’est en soutien résolu de cette économie et cette puissance militaire que la volonté politique doit s’exercer.
Dans Economie du Bien Commun, Jean Tirole l’a bien vu quand il écrit : « Notre choix de société n’est pas un choix entre Etat et marché, comme voudrait nous le faire croire interventionnistes et partisans du laisser-faire. L’Etat et le marché sont complémentaires et non exclusifs. […] ». Les entreprises devraient pouvoir revendiquer une bien plus grande liberté pleine dans la conduite de leur développement, tout en bénéficiant de l’appui de l’Etat pour la mise en place de cadres juridiques adaptés. Cet accompagnement est d’autant plus nécessaire lorsqu’elles sont confrontées à des procédures injustes à l’étranger ou à des violations des règles du droit international, comme nous l’observons trop souvent aujourd’hui. A chacun son rôle.
A cette fin, les entreprises françaises devraient s’engager plus visiblement, de façon directe ou indirecte, au travers des associations professionnelles, des instituts de recherche ou encore des think tanks spécialisés, dans les débats sur une bonne gouvernance de l’Etat. Car si celui-ci se considère légitime à interférer dans les affaires des entreprises, ces dernières ne devraient pas rester inertes ou en marge des débats touchant à la construction et au fonctionnement de l’Etat. Pour la préservation du bien commun, la recherche du juste équilibre mutuel entre l’Etat et les entreprises est l’affaire de tous et doit être en permanence recherché.
Stéphane Beemelmans,
Ancien secrétaire d’État à la Défense en Allemagne
Administrateur de Synopia